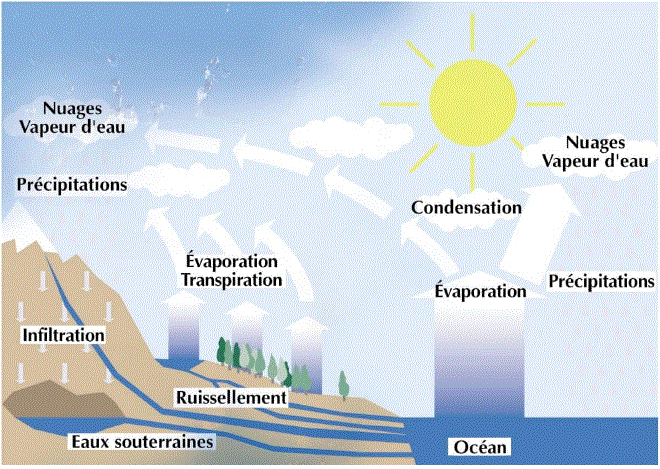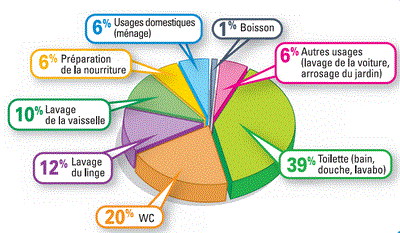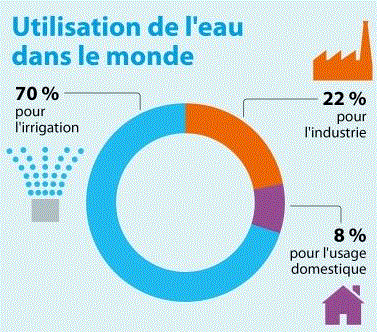Différences entre versions de « Eau »
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{Latin(Aqua); Grec( Hydro); Français(Eau); Arabe(ماء) }<!-- ************** Fin Fiche Didactique Traduction ********************* --> | {Latin(Aqua); Grec( Hydro); Français(Eau); Arabe(ماء) }<!-- ************** Fin Fiche Didactique Traduction ********************* --> | ||
| − | = {{:Définition | + | = {{:Définition}} = |
| − | + | * L'eau est une substance chimique constituée de l'association de molécules H2O . | |
| − | |||
| − | |||
| − | *L'eau est une substance chimique constituée de l'association de molécules H2O . | ||
Elles est partout sur la terre et dans l’atmosphère et existe sous trois états | Elles est partout sur la terre et dans l’atmosphère et existe sous trois états | ||
solide (glace) , liquide et gazeux ( vapeur d'eau). | solide (glace) , liquide et gazeux ( vapeur d'eau). | ||
Version du 3 décembre 2018 à 05:02
{Widget:Traduction-Fiche}}
{Latin(Aqua); Grec( Hydro); Français(Eau); Arabe(ماء) }
= Qu'est ce qu'une définition
Une définition est une explication précise et claire du sens ou de la signification d'un terme, d'un concept, d'une idée ou d'un phénomène donné. Elle vise à fournir une compréhension claire et concise d'un sujet donné, en utilisant un langage précis et approprié au contexte. Les définitions sont souvent utilisées dans les domaines académiques, scientifiques et techniques, ainsi que dans les dictionnaires et les encyclopédies pour aider les lecteurs à comprendre les termes et les concepts utilisés dans ces domaines.
Une définition est une proposition qui dit ce qu'est une chose ou ce que signifie un mot.
Différence entre "définitions réelles" et les définitions nominales"
- Les "définitions réelles" (ou "définitions par essence") sont des définitions qui tentent de décrire la nature fondamentale d'un objet, d'une entité ou d'un concept. Elles cherchent à identifier les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires et suffisantes pour définir l'objet ou le concept en question. Par exemple, une définition réelle de la planète Terre pourrait être "un corps céleste rocheux qui orbite autour du Soleil".
- Les "définitions nominales" (ou "définitions par convention") sont des définitions qui décrivent simplement la façon dont un mot ou un concept est utilisé dans un langage particulier, ou dans une communauté donnée. Elles définissent un mot en fonction de son utilisation ou de sa signification conventionnelle, plutôt que de sa nature fondamentale. Par exemple, une définition nominale du mot "bureau" pourrait être "un meuble qui sert de surface de travail pour écrire, dessiner ou travailler sur un ordinateur".
En résumé, les définitions réelles cherchent à décrire la nature fondamentale d'un objet ou d'un concept, tandis que les définitions nominales décrivent simplement la façon dont un mot ou un concept est utilisé dans une langue ou dans une communauté donnée.
Rhétorique
Selon les Définitions du pseudo-Platon, la définition est la Modèle:Citation. Aristote, dans le Topiques, définit le mot comme Modèle:Citation[1],[2]
Mathématiques
En mathématiques, on parle de délimitation précise d’un concept dans un cadre plus général en utilisant d’autres concepts.
Vocabulaire
Une définition est une formule qui indique la signification d'un terme. Une définition pose une équivalence entre un terme (signifiant) et un sens (signifié). Elle autorise à remplacer le second par le premier et revêt ainsi une utilité pratique. Elle est également le résultat d'une opération, et introduit donc le temps (le sens défini est fini, passé, en-soi), ainsi qu'un acteur (souvent implicite).
La définition s'inscrit dans l'ordre de la dénotation, mais un terme connote également des sens, et ce sans faire explicitement appel au temps ou à un acteur. Il le fait grâce à une structure externe de l'espace des signifiants, mais il existe également une structure interne qui s'exprime à travers l'étymologie. Le concept de définition ne s’impose pas de lui-même, c'est un outil utile, mais pas indifférent : il s'inscrit dans une totalité structurée. Il implique et il indique des choix : Quels acteurs sert-elle ?
La définition établit une frontière entre le mot défini, et les mots utilisés pour l'expliciter. Elle établit ainsi une structure ordonnée, une arborescence par niveaux entre des classes de mots. On voit bien que cette structure est pourtant locale, que cet ordre ne se conserve pas si on déroule la structure de proche en proche.
La problématique de définir la définition
Selon Lalande dans son Dictionnaire critique, Modèle:Citation Plus profondément, la définition expose en un discours articulé (composé au minimum de deux mots) la compréhension d'un concept. Dire qu'un animal est un vivant doué de connaissance sensible, par exemple, c'est articuler entre elles deux notions (vivant et doué de connaissance sensible) qui entrent dans la constitution et qui permettent de saisir la nature d'une troisième (animal).
Il y a évidemment un cercle à définir c'est bien le concept de définition : la tentative même suppose le problème résolu, et semble nier l'intérêt de la démarche (pourquoi définir définition si par là-même on suppose la définition connue ?). C'est ce que la philosophie anglo-saxonne appelle un point aveugle de la raison.
Ainsi la définition proposée ci-dessus du mot définition emploie elle-même d'autres mots, dont on suppose qu'ils ont eux-mêmes une définition. Mais le problème est d'abord celui du sens : comment peut-on appréhender le sens des mots ? La réponse varie considérablement d'un auteur à l'autre. Par exemple, pour Platon, le sens est immuable, et il sert de fondement à notre connaissance ; pour Quine, en revanche, le sens est indéterminé, et dépend toujours d'un ensemble de théories et de concepts.
Le problème concerne ainsi la théorie de la connaissance et de la référence.
Dans l'exemple cité, l'auteur subordonne la définition au concept, à son extension et à sa détermination. Le paradoxe créé, demandera-t-on, n'est-il pas un mouvement dialectique de la pensée ? Sans doute, si cette pensée est action, et revendiquée en tant que telle, mais non pas si elle est résultat. Une vérité immanente qui contiendrait des paradoxes n'est qu'une négation de la raison, une base pour le réenchantement du monde que dénonce Max Weber. Mais une dénonciation s'appuie sans doute elle-même sur une vérité immanente, à moins de prétendre à une perspective transcendante. On peut alors en venir à une forme de relativisme (cf. scepticisme ou post-modernisme), à défaut de trouver une rationalité minimale qui nous assure que les mots que nous utilisons ont un sens et donc une définition.
La question est de savoir pour quel sens du mot « définition » un discours est sensé.
Définition classique dite scolastique ou par la genre prochain et la différence spécifique
La définition (definitio) est l'expression énonçant l'équivalence d'un défini (definiendum) et de son définissant (definiens).
Le défini et le définissant doivent avoir la même extension.
Le définissant est l'espèce (species) dont relève le défini.
L'espèce est énoncée par le genre prochain et la différence spécifique (per genus proximus et differentiam specificam).
La différence spécifique (differentia specifica) est le caractère qui distingue une espèce des autres espèces d'un même genre.
Conceptions de la définition
L'inventeur de la définition serait, selon Aristote, Socrate. Socrate cherche en effet ce qui fait qu'une chose est telle qu'elle est : par exemple, dans l’Hippias majeur, pourquoi cette chose belle est-elle belle ? Il y aurait ainsi un caractère commun aux choses belles, une essence, dont la formulation est la définition.
Cependant, le point de départ de Socrate est existentiel : il s'agit de prendre conscience de ce que nous disons et de ce que nous faisons quand nous suivons des conceptions morales ou scientifiques. La définition permet de mettre à l'épreuve notre prétendu savoir, surtout quand Socrate montre à ses interlocuteurs qu'ils ne savent pas produire une définition cohérente de ce qu'ils pensent : ils ne pensent donc rien de défini, rien qui n'ait une extension précise et bien déterminée. Dans le meilleur des cas, ce sont des ignorants, dans le pire des imposteurs.
Les problèmes liés à la définition (en particulier le problème du paradoxe donné plus haut) ont été des motivations dans la recherche pour tous les philosophes. En effet, l'analyse des concepts et de ce que l'on veut dire, la recherche de l'extension des concepts que nous utilisons, est l'un des aspects majeurs de la philosophie, de Platon et Aristote à Locke, Hume et toute la philosophie anglo-saxonne notamment.
Logique
En logique, une définition est un énoncé qui introduit un symbole appelé terme dénotant le même objet qu’un autre symbole, ou associé à une suite appelée assemblage, de symboles dont la signification est déjà connue.
Certains symboles comme ceux de l'existence, l'appartenance, la négation etc. qui ne peuvent être définis, sont grossièrement introduits en faisant appel à des mots du langage naturel et à l’idée intuitive que l’homme peut en avoir. Ces termes primitifs appartiennent au « domaine intuitif de base ». (Concept des mots non définis utilisé par Alfred Korzybski)
En mathématiques, une définition est un énoncé écrit en langage naturel ou en langage formel (de la logique), qui introduit un nouveau mot ou symbole associé à un objet abstrait décrit par un assemblage d’autres mots ou symboles dont le sens a déjà été précisé.
L’idée que nous avons de l’objet ainsi défini, s’appelle une notion mathématique.
Ces mots ou symboles sont des « abréviations », destinées à représenter de tels assemblages de lettres et de symboles. Ces abréviations permettent à un mathématicien d’utiliser l’objet mathématique ainsi construit sans avoir à l’esprit sa définition complète et détaillée. Dans la pratique, les abréviations sont des lettres alphabétiques, des signes ou des mots ordinaires, par exemple :
- π représente un nombre
- e représente l’exponentielle de 1
- « point » et « droite » sont des objets géométriques
- Les signes + et × sont des « lois »
Donnons maintenant quelques exemples de définitions :
- Soit A un nombre entier positif. Posons B=A.
Nous définissons B comme étant le même nombre représenté par A.
- Soit D et D’ deux droites non parallèles. Soit I le point d’intersection de D et D’.
Nous définissons le point I et nous sommes supposés connaître ce que sont une droite, le parallélisme et un point d’intersection.
- Un nombre entier naturel est dit premier s'il est différent de 1 et s’il n’admet comme diviseurs que 1 et lui-même.
Une définition n’est pas un théorème, elle donne simplement une dénomination à des objets mathématiques mais ne décrit pas de règles d’utilisation de ces objets ou de propriétés vérifiées par ces objets (autres que celles qui le définissent).
Lorsque nous définissons un objet, nous utilisons en général un « si » qui signifie « si par définition », « quand » ou « lorsque », comme dans la définition suivante :
Un nombre entier relatif n est pair si ∃k ∈ ℤ, n = 2k.
Certains utilisent maladroitement un « si et seulement si » à la place du « si », mais cela n’a pas de sens, puisqu’ils écrivent dans ce cas une équivalence entre un terme qui n’est pas une proposition qui, de plus, n’est pas encore défini et une proposition.
Si la définition d’un objet donné suppose qu’une proposition P soit vérifiée, alors l’affirmation « par définition » ou « en vertu de la définition » la proposition P est vérifiée signifie que nous utilisons la proposition P intrinsèque à l’objet. Considérons la définition suivante :
Modèle:Souligner : Un carré est un quadrilatère dont les côtés sont de même longueur et dont les angles sont droits.
Il est évident que tous les côtés d’un carré sont de longueur égale parce que cette propriété fait partie de la définition. Nous pouvons dire dans ce cas « par définition », un carré a tous ses côtés d’égale longueur.
Si un même objet mathématique (ou « être mathématique ») reçoit plusieurs définitions et que toutes les propriétés de l’une d’entre elles sont équivalentes à celles des autres, alors ces définitions sont dites équivalentes.
Une définition n’a de sens que dans le cadre d’une théorie mathématique donnée et par exemple il est impossible de considérer une fonction dérivable définie sur l’ensemble des entiers naturels à valeurs dans ℝ.
Dans un exposé mathématique, il arrive qu’une définition « intuitive » soit donnée avant la définition mathématique ; son rôle est de mettre en évidence les motivations d’une telle définition. Par exemple, des définitions de dictionnaire: explication d'un mot.
Notes et références
- ↑ 101 b-102
- ↑ Pellegrin 2014, p. 301
Bibliographie
- (fr) Pierre Pellegrin (dir.), Aristote : Œuvres complètes, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2081273160)
- Richard Bodeüs (dir.), Aristote : Œuvres. Éthiques, Politique, Rhétorique, Poétique, Métaphysique, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », (ISBN 9782070113590, présentation en ligne)
- Fritz Reinhardt et Heinrich Soeder, Atlas des Mathématiques, Paris, Fayard, coll. « La Pochotèque », (1re éd. 1974) (ISBN 978-2-253-13013-0), p. 21
- Luc Brisson (trad. du français), Définitions, Éditions Gallimard, (1re éd. 2006) (ISBN 978-2-0812-1810-9)
Voir aussi
=
- L'eau est une substance chimique constituée de l'association de molécules H2O .
Elles est partout sur la terre et dans l’atmosphère et existe sous trois états
solide (glace) , liquide et gazeux ( vapeur d'eau).
L'eau est un constituant biologique important , et l'eau liquide est
essentielle pour tous les organismes vivants . C'est une ressource naturelle dont la gestion est l'objet des enjeux géopolitiques , compte tenu de son caractère vital , de son inégal répartition sur la terre et de son importance dans l’économie.
Formes de l'eau sur terre : Le cycle de l'eau ou cycle hydrologique se rapporte à l'échange continu de l'eau entre l'hydrosphère ,
atmosphère l'eau des sols , l'eau de surface les nappes phréatiques et les plantes
L'eau liquide est trouvée dans les océans , les mers , les lacs aussi dans de cours d'eau
comme les fleuves , les rivières , les canaux et les étangs.
=
Eau : nom féminin, au pluriel : eaux. Liquide naturel transparent, sans goût, incolore et inodore qui durcit au gel et se vaporise sous l’effet de la chaleur. L’eau a une teinte bleuâtre, qui peut être perçue uniquement lorsqu’elle forme une couche épaisse.
Eau : Corps liquide à la température et à la pression ordinaires, incolore, inodore, insipide, dont les molécules sont composées d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène.Ce corps liquide, contenant en solution ou en suspension toutes sortes d'autres corps (sels, gaz, micro-organismes, etc.), très répandu à la surface terrestre (eau de pluie, eau de mer, eau du robinet, etc.) et constitue le Suc de certains fruit et designe le Nom de certaines solutions aqueuses (eau de brome, eau boriquée, eau de chlore, etc.) et de certains liquides (eau de Javel, eau régale, etc.).
Le cycle de l'eau se définit comme la circulation générale de l'eau, en circuit fermé et avec changements d'état, entre les réservoirs de l'hydrosphère - océan, atmosphère, surface et sous-sol des terres émergées - mettant en jeu les phénomènes d'évaporation, de convection, de condensation et précipitation, d'écoulement et d'infiltration, ainsi que les variations et renouvellements des stocks dans ces réservoirs. Le cycle de l'eau, mu par l'énergie solaire, joue un rôle fondamental sur la redistribution de celle-ci à la surface de la Terre.
Cycle de l'eau
Le cycle de l'eau dans la biosphère est intimement lié à celui de l'énergie.
Le cycle de l'eau est d'abord initié par la distillation de l'eau de mer, principalement importante dans les régions intertropicales du globe. À ce niveau, près du quart de la chaleur fournie par jour par le soleil est stockée dans les 3 premiers mètres des océans. Cette énergie va permettre l'évaporation de l'eau. La vapeur d'eau, en se condensant dans les nuages, restitue une partie de cette énergie laquelle sert au réchauffement de l'atmosphère. Le réchauffement de l'atmosphère déclenche la circulation atmosphérique qui va entraîner les stratus et les stratocumulus néoformés.
L'eau stockée dans les nuages sous forme de vapeur, d'eau liquide ou de cristaux de glace précipite, sous l'effet de la gravité, sous forme de pluie, de neige ou de grêle, d'abord et principalement sur les océans et pour partie sur les continents.Les précipitations, quand elles arrivent sur les sols, ruissellent ou s'infiltrent, sont partiellement évaporées ou évapotranspirées. Au final, l'eau retourne à l'océan ou à l'atmosphère.
Corps liquide à la température et à la pression ordinaires, incolore, inodore, insipide, dont les molécules sont composées d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène.
Ce corps liquide, contenant en solution ou en suspension toutes sortes d'autres corps (sels, gaz, micro-organismes, etc.), très répandu à la surface terrestre (eau de pluie, eau de mer, eau du robinet, etc.).
La mer, les rivières, les lacs, etc. : Aller au bord de l'eau.
Liquide organique ; sérosité : La cloque était pleine d'eau.
Bouillon de cuisson : Eau de riz.
Pluie : Il est tombé des trombes d'eau.
Suc de certains fruits.
Nom donné à divers liquides alcooliques ou obtenus par distillation, par infusion, etc. : De l'eau de Cologne.
Transparence d'une pierre ; éclat d'une perle lié à son velouté et à son orient.
Littéraire. Transparence, limpidité de quelque chose : L'eau claire et profonde de ses yeux.
Chimie
Nom de certaines solutions aqueuses (eau de brome, eau boriquée, eau de chlore, etc.) et de certains liquides (eau de Javel, eau régale, etc.).
PARCOURS DE L'EAU DANS LE CORPS HUMAIN
Toute molécule d'eau qui se trouve dans les intestins n'a que deux possibilités : soit elle est éliminée dans les selles, soit elle est absorbée par une cellule de la paroi intestinale. De là, elle va rapidement diffuser dans le sang qui parcourt les vaisseauxde la paroi intestinale. De là elle gagne le foie. À ce niveau, soit elle est absorbée par une cellule du foie pour servir de diluant du milieu intérieur de la cellule hépatique, soit elle poursuit son chemin dans le sang. Là elle n'a que trois possibilités : . Soit à un moment quelconque de son parcours, elle pourra être récupérée par une cellule quelconque du corps. • Soit elle va passer dans un tissu (par exemple le tissu sur lequel repose la peau, ou le tissu de soutien des poumons ou celui d'un organe quelconque du corps). • Soit elle va à la suite d'un parcours compliqué être éliminée par le rein dans les urines. Son parcours est donc à la fois très précis et très aléatoire
}}
 Concepts ou notions associés
Concepts ou notions associés
 Exemples, applications, utilisations
Exemples, applications, utilisations
 Erreurs ou confusions éventuelles
Erreurs ou confusions éventuelles
- Confusion entre ....... et ........
- Confusion entre ....... et ........
- Erreur fréquente: ....................
 Questions possibles
Questions possibles
 Liaisons enseignements et programmes
Liaisons enseignements et programmes
Idées ou Réflexions liées à son enseignement
Aides et astuces
Education: Autres liens, sites ou portails
 Bibliographie
Bibliographie
Pour citer cette page: ([1])
ABROUGUI, M & al, 2018. Eau. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Eau>, consulté le 31, mai, 2024
- ..................
- ..................
- ..................
- ..................