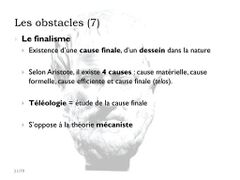Différences entre versions de « Finalisme »
| (28 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
=[[Finalisme]]= | =[[Finalisme]]= | ||
=Quelques définitions= | =Quelques définitions= | ||
| − | + | [[ PHILOS]]. Système de pensée qui admet la finalité comme principe d'explication des phénomènes dans l'univers en général ou dans un domaine limité. Finalisme radical; finalisme chrétien (V. final ex. 2).Mécanisme et finalisme sont trop loin l'un de l'autre (Bergson, Évol. créatr.,1907, p. 92): | |
Les prophètes juifs, suivant leur idée que les révolutions des empires n'ont qu'un but, l'accomplissement des volontés de Iahvé sur Israël, sont (...) les fondateurs de la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire de la tentative d'assujettir tous les événements à un finalisme providentiel. Renan, Hist. peuple Isr.,t. 3, 1891, p. 468. | Les prophètes juifs, suivant leur idée que les révolutions des empires n'ont qu'un but, l'accomplissement des volontés de Iahvé sur Israël, sont (...) les fondateurs de la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire de la tentative d'assujettir tous les événements à un finalisme providentiel. Renan, Hist. peuple Isr.,t. 3, 1891, p. 468. | ||
Prononc. : [finalism̥]. Étymol. et Hist. 1890 (Renan, Avenir sc., p. 258). | Prononc. : [finalism̥]. Étymol. et Hist. 1890 (Renan, Avenir sc., p. 258). | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
« Ainsi donc, toutes les fois que les choses se produisent accidentellement comme elles se seraient produites en ayant un but, elles subsistent et se conservent, parce qu'elles ont pris spontanément la condition convenable ; mais celles où il en est autrement périssent ou ont péri. » (Ibid. ; cet évolutionnisme rudimentaire est celui d'Empédocle.) | « Ainsi donc, toutes les fois que les choses se produisent accidentellement comme elles se seraient produites en ayant un but, elles subsistent et se conservent, parce qu'elles ont pris spontanément la condition convenable ; mais celles où il en est autrement périssent ou ont péri. » (Ibid. ; cet évolutionnisme rudimentaire est celui d'Empédocle.) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*La position d'Aristote est donc en retrait[En quoi ?] sur celle de Socrate et de Platon (cf. le Timée), car il n'attribue pas la finalité à un Démiurge auteur, ni même organisateur de la nature. Son finalisme n'est pas intentionnel mais immanent. | *La position d'Aristote est donc en retrait[En quoi ?] sur celle de Socrate et de Platon (cf. le Timée), car il n'attribue pas la finalité à un Démiurge auteur, ni même organisateur de la nature. Son finalisme n'est pas intentionnel mais immanent. | ||
| Ligne 42 : | Ligne 36 : | ||
« Les yeux n’ont pas été créés, comme tu pourrais le croire, pour nous permettre de voir au loin ; ce n’est pas davantage pour nous permettre de marcher à grands pas que l’extrémité des jambes et des cuisses s’appuie et s’articule sur les pieds ; non plus que les bras que nous avons attachés à de solides épaules, les mains qui nous servent des deux côtés ne nous ont été donnés pour subvenir à nos besoins. Interpréter les faits de cette façon, c’est faire un raisonnement qui renverse l’ordre des choses : c’est mettre partout la cause après l’effet. Aucun organe de notre corps, en effet, n' a été créé pour notre usage, mais c’est l’organe qui crée l’usage. La vision n’existait pas avant la naissance des yeux, non plus que la parole avant la création de la langue : c’est bien plutôt l’existence de la langue qui a précédé de loin la parole et les oreilles existaient bien avant que ne fût entendu un son. En bref, tous les organes, à mon avis, existèrent avant qu’on en fît usage. Ils n’ont donc pas pu être créés en vue de leur fonction. » (Lucrèce, De Natura rerum, IV, v. 824-842) | « Les yeux n’ont pas été créés, comme tu pourrais le croire, pour nous permettre de voir au loin ; ce n’est pas davantage pour nous permettre de marcher à grands pas que l’extrémité des jambes et des cuisses s’appuie et s’articule sur les pieds ; non plus que les bras que nous avons attachés à de solides épaules, les mains qui nous servent des deux côtés ne nous ont été donnés pour subvenir à nos besoins. Interpréter les faits de cette façon, c’est faire un raisonnement qui renverse l’ordre des choses : c’est mettre partout la cause après l’effet. Aucun organe de notre corps, en effet, n' a été créé pour notre usage, mais c’est l’organe qui crée l’usage. La vision n’existait pas avant la naissance des yeux, non plus que la parole avant la création de la langue : c’est bien plutôt l’existence de la langue qui a précédé de loin la parole et les oreilles existaient bien avant que ne fût entendu un son. En bref, tous les organes, à mon avis, existèrent avant qu’on en fît usage. Ils n’ont donc pas pu être créés en vue de leur fonction. » (Lucrèce, De Natura rerum, IV, v. 824-842) | ||
*Aux mécanistes, l'explication par les fins paraît donc une faute logique, une inversion de l'effet et de la cause qu'on peut illustrer par cette boutade attribuée à Henry Monnier : « La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie sachant que c'est la région où l'on boit le plus de cidre. ». | *Aux mécanistes, l'explication par les fins paraît donc une faute logique, une inversion de l'effet et de la cause qu'on peut illustrer par cette boutade attribuée à Henry Monnier : « La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie sachant que c'est la région où l'on boit le plus de cidre. ». | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*Aristote définit dans la recherche des causes la cause finale, qui est un but à atteindre. Le but (la fin) poursuivi devient la cause première, le début et non la fin de la chaîne. Elle est associée à une pensée consciente, intelligente, attribuée à la divinité créatrice. Le finalisme est donc l’idée que les choses se produisent à cause du but à atteindre. Cela va à l’encontre du mécanisme, soutenu par Descartes, qui se base sur des relations de cause à effet limitées au monde physique et exclue ainsi la considération des fins. | *Aristote définit dans la recherche des causes la cause finale, qui est un but à atteindre. Le but (la fin) poursuivi devient la cause première, le début et non la fin de la chaîne. Elle est associée à une pensée consciente, intelligente, attribuée à la divinité créatrice. Le finalisme est donc l’idée que les choses se produisent à cause du but à atteindre. Cela va à l’encontre du mécanisme, soutenu par Descartes, qui se base sur des relations de cause à effet limitées au monde physique et exclue ainsi la considération des fins. | ||
| Ligne 115 : | Ligne 106 : | ||
{{Conceptions erronées}} | {{Conceptions erronées}} | ||
| − | * | + | |
| + | *confondre finalisme et efficience( or la cause efficiente est le contraire de la cause finale ) | ||
| + | |||
| + | *Dogme finaliste :vouloir tout expliquer par le finalisme | ||
| + | |||
| + | *vouloir expliquer un tel fonctionnement dans la nature susceptible à être fini à tout moment tout en rejetant la conception finaliste. | ||
| + | |||
| + | *admettre que le finalisme est étranger aux préoccupations scientifiques de notre temps. La science ne recherche pas les causes finales. Son domaine est le déterminisme, non le finalisme. | ||
| + | |||
| + | *confusion entre finalisme et créationnisme : cherchent, l'un comme l'autre, à s'accaparer quelque chose du domaine de la science. | ||
| + | = Les contradictions du finalisme = | ||
== Le problème du finalisme et du déterminisme == | == Le problème du finalisme et du déterminisme == | ||
se pose dès l'Antiquité, dans les mêmes termes à peu près où il se pose encore aujourd'hui. Aristote a présenté les deux options possibles dans sa Physique. D'abord la position mécaniste, pour laquelle tout s'explique par les causes efficientes ou, si l'on préfère, par les lois aveugles de la nature. Leur combinaison aboutit accidentellement au monde naturel tel que nous le voyons : | se pose dès l'Antiquité, dans les mêmes termes à peu près où il se pose encore aujourd'hui. Aristote a présenté les deux options possibles dans sa Physique. D'abord la position mécaniste, pour laquelle tout s'explique par les causes efficientes ou, si l'on préfère, par les lois aveugles de la nature. Leur combinaison aboutit accidentellement au monde naturel tel que nous le voyons : | ||
| Ligne 130 : | Ligne 131 : | ||
*La position d'Aristote est donc en retrait[En quoi ?] sur celle de Socrate et de Platon (cf. le Timée), car il n'attribue pas la finalité à un Démiurge auteur, ni même organisateur de la nature. Son finalisme n'est pas intentionnel mais immanent. | *La position d'Aristote est donc en retrait[En quoi ?] sur celle de Socrate et de Platon (cf. le Timée), car il n'attribue pas la finalité à un Démiurge auteur, ni même organisateur de la nature. Son finalisme n'est pas intentionnel mais immanent. | ||
| − | + | == Le finalisme a été critiqué avant et après Aristote par les matérialistes == | |
| + | tels qu'Empédocle, Démocrite, Épicure ou Lucrèce : expliquer les phénomènes par leur fin paraît en effet contraire au bon sens, puisqu'une cause précède ses effets. Ainsi pour Lucrèce, ce n'est pas la fonction qui crée l'organe, mais l'organe qui crée la fonction ; ce n'est pas la vue qui fait que l'on a des yeux, mais les yeux qui permettent la vue : | ||
« Les yeux n’ont pas été créés, comme tu pourrais le croire, pour nous permettre de voir au loin ; ce n’est pas davantage pour nous permettre de marcher à grands pas que l’extrémité des jambes et des cuisses s’appuie et s’articule sur les pieds ; non plus que les bras que nous avons attachés à de solides épaules, les mains qui nous servent des deux côtés ne nous ont été donnés pour subvenir à nos besoins. Interpréter les faits de cette façon, c’est faire un raisonnement qui renverse l’ordre des choses : c’est mettre partout la cause après l’effet. Aucun organe de notre corps, en effet, n' a été créé pour notre usage, mais c’est l’organe qui crée l’usage. La vision n’existait pas avant la naissance des yeux, non plus que la parole avant la création de la langue : c’est bien plutôt l’existence de la langue qui a précédé de loin la parole et les oreilles existaient bien avant que ne fût entendu un son. En bref, tous les organes, à mon avis, existèrent avant qu’on en fît usage. Ils n’ont donc pas pu être créés en vue de leur fonction. » (Lucrèce, De Natura rerum, IV, v. 824-842) | « Les yeux n’ont pas été créés, comme tu pourrais le croire, pour nous permettre de voir au loin ; ce n’est pas davantage pour nous permettre de marcher à grands pas que l’extrémité des jambes et des cuisses s’appuie et s’articule sur les pieds ; non plus que les bras que nous avons attachés à de solides épaules, les mains qui nous servent des deux côtés ne nous ont été donnés pour subvenir à nos besoins. Interpréter les faits de cette façon, c’est faire un raisonnement qui renverse l’ordre des choses : c’est mettre partout la cause après l’effet. Aucun organe de notre corps, en effet, n' a été créé pour notre usage, mais c’est l’organe qui crée l’usage. La vision n’existait pas avant la naissance des yeux, non plus que la parole avant la création de la langue : c’est bien plutôt l’existence de la langue qui a précédé de loin la parole et les oreilles existaient bien avant que ne fût entendu un son. En bref, tous les organes, à mon avis, existèrent avant qu’on en fît usage. Ils n’ont donc pas pu être créés en vue de leur fonction. » (Lucrèce, De Natura rerum, IV, v. 824-842) | ||
| Ligne 142 : | Ligne 144 : | ||
La confusion entre les deux niveaux - aussi légitimes l'un que l'autre mais qui doivent être distingués ; voir par exemple la distinction célèbre de Dilthey entre sciences de l'esprit et sciences de la nature (explicatives) et sciences de l'esprit (compréhensives) - est à l'origine de bien des errements, entre autres dans le débat sur l'intelligent design, théorie dont la scientificité est douteuse. Mais la science n'a pas vocation à répondre aux questions ultimes, dont celle de la finalité fait partie ; c'est du moins le point de vue de Kant dans la Critique de la raison pure, lorsqu'il affirme une séparation complète de la métaphysique et des sciences empiriques. | La confusion entre les deux niveaux - aussi légitimes l'un que l'autre mais qui doivent être distingués ; voir par exemple la distinction célèbre de Dilthey entre sciences de l'esprit et sciences de la nature (explicatives) et sciences de l'esprit (compréhensives) - est à l'origine de bien des errements, entre autres dans le débat sur l'intelligent design, théorie dont la scientificité est douteuse. Mais la science n'a pas vocation à répondre aux questions ultimes, dont celle de la finalité fait partie ; c'est du moins le point de vue de Kant dans la Critique de la raison pure, lorsqu'il affirme une séparation complète de la métaphysique et des sciences empiriques. | ||
| − | + | == Le finalisme rejeté avec vigueur par les évolutionnistes darwiniens == | |
| + | celui qui associe l’apparition d’un organe à un plan, à une intention. | ||
== le finalisme est incompatible avec le panthéisme == | == le finalisme est incompatible avec le panthéisme == | ||
| Ligne 166 : | Ligne 169 : | ||
Par exemple, quand un élève affirme que l'homme n'est pas un animal, il renonce à sa fusion affective avec la nature. Cette séparation, condition nécessaire pour mener à bien une observation raisonnée sur le vivant, n'est pas pour autant suffisante pour engager un processus de décentration, c'est-à-dire renoncer à l'anthropocentrisme. Le travail pédagogique ne peut donc se limiter à rappeler que la vie s'est développée sur Terre depuis plus de trois milliards d'années sans la présence de l'homme. Une telle présentation peut même renforcer l'idée selon laquelle l'homme est l'accomplissement de l'évolution, et que jamais il ne connaîtra d'extinction. | Par exemple, quand un élève affirme que l'homme n'est pas un animal, il renonce à sa fusion affective avec la nature. Cette séparation, condition nécessaire pour mener à bien une observation raisonnée sur le vivant, n'est pas pour autant suffisante pour engager un processus de décentration, c'est-à-dire renoncer à l'anthropocentrisme. Le travail pédagogique ne peut donc se limiter à rappeler que la vie s'est développée sur Terre depuis plus de trois milliards d'années sans la présence de l'homme. Une telle présentation peut même renforcer l'idée selon laquelle l'homme est l'accomplissement de l'évolution, et que jamais il ne connaîtra d'extinction. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Dans la pensée religieuse, l'histoire est conçue comme la perspective d'un projet transcendantal (finalité a priori), tandis qu'en biologie de l'évolution, elle est décrite comme une rétrospective, intelligible uniquement en termes de mécanismes naturels (finalité a posteriori ou téléonomie) sans préciser ni direction ni but. | Dans la pensée religieuse, l'histoire est conçue comme la perspective d'un projet transcendantal (finalité a priori), tandis qu'en biologie de l'évolution, elle est décrite comme une rétrospective, intelligible uniquement en termes de mécanismes naturels (finalité a posteriori ou téléonomie) sans préciser ni direction ni but. | ||
| Ligne 186 : | Ligne 185 : | ||
« On ne trouve point que ce soit un hasard ni une chose accidentelle qu'il pleuve fréquemment en hiver ; mais c'est un hasard, au contraire, s'il pleut quand le soleil est dans la constellation du chien. Ce n'est pas davantage un hasard qu'il y ait de grandes chaleurs durant la canicule ; mais c'en est un qu'il y en ait en hiver. (…) On entend par choses naturelles toutes celles qui, mues continûment par un principe qui leur est intime, arrivent à une certaine fin. De chacun de ces principes, ne sort pas pour chaque espèce de chose un résultat identique, de même qu'il n'en sort pas un résultat arbitraire ; mais toujours le principe tend au même résultat, à moins d'obstacle qui l'arrête. (…) Quand c'est toujours ou du moins le plus ordinairement qu'une chose arrive, ce n'est plus ni par accident ni par hasard ; or, dans la nature, les choses se produisent éternellement de la même façon, si rien ne s'y oppose. » (Ibid.) | « On ne trouve point que ce soit un hasard ni une chose accidentelle qu'il pleuve fréquemment en hiver ; mais c'est un hasard, au contraire, s'il pleut quand le soleil est dans la constellation du chien. Ce n'est pas davantage un hasard qu'il y ait de grandes chaleurs durant la canicule ; mais c'en est un qu'il y en ait en hiver. (…) On entend par choses naturelles toutes celles qui, mues continûment par un principe qui leur est intime, arrivent à une certaine fin. De chacun de ces principes, ne sort pas pour chaque espèce de chose un résultat identique, de même qu'il n'en sort pas un résultat arbitraire ; mais toujours le principe tend au même résultat, à moins d'obstacle qui l'arrête. (…) Quand c'est toujours ou du moins le plus ordinairement qu'une chose arrive, ce n'est plus ni par accident ni par hasard ; or, dans la nature, les choses se produisent éternellement de la même façon, si rien ne s'y oppose. » (Ibid.) | ||
| − | |||
| − | |||
=Le primat des causes finales= | =Le primat des causes finales= | ||
| Ligne 208 : | Ligne 205 : | ||
*Le finalisme d'Aristote est une application de sa théorie des quatre causes de la substance : Pour lui, il n'y a pas lieu d'opposer causes efficientes et cause finale : celles-là sont subordonnées à celle-ci, comme des moyens mis en œuvre pour arriver à un but. La fin qu'on observe dans la nature en dernière analyse, c'est la conservation des formes naturelles : « La forme étant une fin, et tout le reste s'ordonnant en vue de la fin et du but, on peut dire que la forme est le pourquoi des choses et leur cause finale. » (Ibid.) Il s'agit donc d'une finalité immanente à la nature, laquelle œuvre ainsi à sa propre conservation.Il n'y a pas de créateur, mais seulement un « Premier moteur » qui meut l'univers tout entier en tant que cause finale ultime. | *Le finalisme d'Aristote est une application de sa théorie des quatre causes de la substance : Pour lui, il n'y a pas lieu d'opposer causes efficientes et cause finale : celles-là sont subordonnées à celle-ci, comme des moyens mis en œuvre pour arriver à un but. La fin qu'on observe dans la nature en dernière analyse, c'est la conservation des formes naturelles : « La forme étant une fin, et tout le reste s'ordonnant en vue de la fin et du but, on peut dire que la forme est le pourquoi des choses et leur cause finale. » (Ibid.) Il s'agit donc d'une finalité immanente à la nature, laquelle œuvre ainsi à sa propre conservation.Il n'y a pas de créateur, mais seulement un « Premier moteur » qui meut l'univers tout entier en tant que cause finale ultime. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Ligne 225 : | Ligne 218 : | ||
<!--------- Commencez les modifications Typologie - Conceptions ----------------------> | <!--------- Commencez les modifications Typologie - Conceptions ----------------------> | ||
| − | |Conception-Type-1= | + | |Conception-Type-1=Philosophie |
| − | |Conception-Type-2= | + | |Conception-Type-2=Courant de pensée |
| − | |Conception-Type-3= | + | |Conception-Type-3=Épistémologie |
| − | |Conception-Type-4= | + | |Conception-Type-4=Histoire des sciences |
| − | |Conception-Type-5= | + | |Conception-Type-5=Finalisme |
| − | |Conception-Type-6= | + | |Conception-Type-6=Déterminisme |
| − | |Conception-Type-7= | + | |Conception-Type-7=Mécanisme |
| − | |Conception-Type-8= | + | |Conception-Type-8=Évolutionnisme |
| − | |Conception-Type-9= | + | |Conception-Type-9=Panthéisme |
| − | |Conception-Type-10= | + | |Conception-Type-10=Téléologie |
| + | |Conception-Type-11=Créationnisme | ||
| + | |Conception-Type-12=Anthropocentrisme | ||
| + | |||
}}<!-- ********************* FIN Fiche Typologie - Conceptions *********************--> | }}<!-- ********************* FIN Fiche Typologie - Conceptions *********************--> | ||
| Ligne 247 : | Ligne 243 : | ||
<!----*** Commencez les modifications Conceptions-ou-Concepts liés ***-----> | <!----*** Commencez les modifications Conceptions-ou-Concepts liés ***-----> | ||
| − | |Concept-lié-1= | + | |Concept-lié-1=Nature |
| − | |Concept-lié-2= | + | |Concept-lié-2=Vie |
| − | |Concept-lié-3= | + | |Concept-lié-3=Biologie |
| − | |Concept-lié-4= | + | |Concept-lié-4=Finalité |
| − | |Concept-lié-5= | + | |Concept-lié-5=Causalité |
| − | |Concept-lié-6= | + | |Concept-lié-6=Efficience |
| − | |Concept-lié-7= | + | |Concept-lié-7=Religion |
| − | |Concept-lié-8= | + | |Concept-lié-8=Dieu |
| − | |Concept-lié-9= | + | |Concept-lié-9=Perspective téléologique |
| − | |Concept-lié-10= | + | |Concept-lié-10=Zoologie |
}}<!-- ****************** FIN Concepts liés aux conceptions ************--> | }}<!-- ****************** FIN Concepts liés aux conceptions ************--> | ||
| Ligne 272 : | Ligne 268 : | ||
<!-- Remplacez, Adaptez, Ajoutez ou Supprimez les images et lignes non utilisées--> | <!-- Remplacez, Adaptez, Ajoutez ou Supprimez les images et lignes non utilisées--> | ||
| − | Image: | + | Image:Finalisme A.png|Finalisme et téléologie |
| − | Image: | + | Image:Fnalisme B.jpeg|Finalisme le miroir du temps |
| − | Image: | + | Image:finalisme C.jpeg|Finalisme selon Aristote |
| + | Image:finalisme D.jpeg|La cause finale | ||
</gallery><!-- ************** Fin modification images***************************--> | </gallery><!-- ************** Fin modification images***************************--> | ||
| Ligne 285 : | Ligne 282 : | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************--> | ||
| − | <youtube width="220" height="220"> | + | <youtube width="220" height="220">=fwzpxEMKkao&t=55s</youtube> |
| − | <youtube width="220" height="220"> | + | <youtube width="220" height="220">=6Ie81-rEytg</youtube> |
| − | <youtube width="220" height="220"> | + | <youtube width="220" height="220">=AFk027OTD3k</youtube> |
}}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************--> | }}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************--> | ||
| − | |||
= {{Widget:Stratégie de changement conceptuelle : Solutions possibles}} = | = {{Widget:Stratégie de changement conceptuelle : Solutions possibles}} = | ||
| Ligne 301 : | Ligne 297 : | ||
<!-- Complétez les pointillés ou supprimez les lignes non utilisées -----> | <!-- Complétez les pointillés ou supprimez les lignes non utilisées -----> | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications ****************************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications ****************************--> | ||
| + | |||
| + | =Quelques stratégies= | ||
| + | *Il sera judicieux de montrer l'apport de cette doctrine dans la compréhension de l'histoire des sciences tout en référant à des textes et des études . | ||
| − | = Finalisme en biologie = | + | *étudier cette doctrine en parallèle avec l'épistémologie pour comprendre les causes de sa naissance . |
| + | |||
| + | *Il est nécessaire de montrer les limites de ce courant de pensée à partir des exemples ainsi que son influence sur l'histoire des sciences. | ||
| + | |||
| + | *Aborder les courants de pensée en concordance avec le finalisme pou bien l' expliquer . | ||
| + | |||
| + | *Aborder les courant de pensés qui sont en discordance avec le finalisme . | ||
| + | |||
| + | *Organiser des débats scientifiques sur les apport-limites du finalisme | ||
| + | |||
| + | *Laisser les élèves s'exprimer :[[état de dévolution]],intervenir, poser des questions, interagir, chercher des argumentations ,et rectifier les conceptions | ||
| + | en relation avec [[causalité et finalité]] | ||
| + | |||
| + | *Apprendre par socio-cognitif: interactions Élève-Élève et Élève-Enseignant. | ||
| + | |||
| + | *utiliser la problématisation. | ||
| + | |||
| + | *Appliquer divers médiations didactiques pour traiter ce sujet . | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *Aider l'élève à prendre conscience que sa conception de l'histoire de la vie est intimement liée à son champ de croyances, c'est l'aider à un travail de distanciation sur son propre référentiel de convictions. C'est aussi intégrer que biologie de l'évolution et religion n'ont pas le même regard sur la nature. Il s'agit, en réalité, de deux visions culturelles de la nature. Là où la science satisfait un besoin de connaissances, la religion répond, quant à elle, à un besoin de justification de l'existence de l'univers, de la Terre, de la vie. La reconnaissance de cette dualité irréductible entre science et religion est, en soi, un objectif pédagogique. | ||
| + | |||
| + | Néanmoins, l'action pédagogique n'a pas à exclure d'autres approches de la nature : religieuse, artistique, philosophique, etc., ni vocation à opposer biologie de l'évolution et religion, mais à préciser que toutes deux appartiennent à des registres de pensée différents. | ||
| + | |||
| + | Dans la pensée religieuse, l'histoire est conçue comme la perspective d'un projet transcendantal (finalité a priori), tandis qu'en biologie de l'évolution, elle est décrite comme une rétrospective, intelligible uniquement en termes de mécanismes naturels (finalité a posteriori ou téléonomie) sans préciser ni direction ni but. | ||
| + | |||
| + | Ne pas reconnaître cette différence de registre, c'est donner droit de citer au créationnisme, c'est subordonner les faits historiques à une possible interprétation religieuse. C'est confondre le déterminisme biologique de la sélection naturelle avec un finalisme historico-religieux. Enfin, c'est prendre le risque de laisser croire, à tort, qu'il existe une concurrence explicative sur l'origine et l'histoire du vivant entre science et religion . | ||
| + | |||
| + | = Exemples de Finalisme en biologie = | ||
== Finalisme,locomotion,zoologie == | == Finalisme,locomotion,zoologie == | ||
| Ligne 311 : | Ligne 339 : | ||
Pour bien délimiter les enjeux, notons que IA ne se prononce pas, sinon de manière très indirecte, sur la cause finale intentionnelle de la locomotion, ce que l’animal identifie comme son bien, réel ou apparent, à savoir l’objet de désir ou le désirable. IA aurait pu s’y intéresser, si l’on considère que l’animal se meut en vue de se nourrir, de se reproduire, de fuir un danger, etc. Toutes ces activités, en effet, supposent la représentation d’un objet de désir, positif ou négatif, et un mouvement dont l’origine psychique est la faculté désirante. Ces questions sont abordées, en revanche, dans le traité De l’âme, mais aussi dans MA, qui se place en quelque sorte au-delà des différences de locomotion, en se situant explicitement au niveau de la cause « commune » à tout type de mouvement local – marche, vol, nage –, cause commune que la lecture de ce traité permet précisément d’identifier comme le bien particulier qui constitue pour l’animal l’objet de son désir. Le IA, peut-être par complémentarité, ne s’occupe pas pour sa part de la finalité intentionnelle et objective, c’est-à-dire des buts externes que l’animal poursuit sciemment et volontairement dans telles ou telles circonstances particulières. Il prend la locomotion elle-même comme fin et analyse les moyens que la nature met en œuvre pour l’atteindre. Ces moyens, je l’ai dit, consistent essentiellement dans l’agencement et la conformation des parties. | Pour bien délimiter les enjeux, notons que IA ne se prononce pas, sinon de manière très indirecte, sur la cause finale intentionnelle de la locomotion, ce que l’animal identifie comme son bien, réel ou apparent, à savoir l’objet de désir ou le désirable. IA aurait pu s’y intéresser, si l’on considère que l’animal se meut en vue de se nourrir, de se reproduire, de fuir un danger, etc. Toutes ces activités, en effet, supposent la représentation d’un objet de désir, positif ou négatif, et un mouvement dont l’origine psychique est la faculté désirante. Ces questions sont abordées, en revanche, dans le traité De l’âme, mais aussi dans MA, qui se place en quelque sorte au-delà des différences de locomotion, en se situant explicitement au niveau de la cause « commune » à tout type de mouvement local – marche, vol, nage –, cause commune que la lecture de ce traité permet précisément d’identifier comme le bien particulier qui constitue pour l’animal l’objet de son désir. Le IA, peut-être par complémentarité, ne s’occupe pas pour sa part de la finalité intentionnelle et objective, c’est-à-dire des buts externes que l’animal poursuit sciemment et volontairement dans telles ou telles circonstances particulières. Il prend la locomotion elle-même comme fin et analyse les moyens que la nature met en œuvre pour l’atteindre. Ces moyens, je l’ai dit, consistent essentiellement dans l’agencement et la conformation des parties. | ||
| − | + | ||
| − | : | + | == Sélection naturelle et finalisme == |
| − | + | Sélection naturelle : principe universel, pendant scientifique du finalisme : explication de l'apparence de finalité car tendance automatique vers optima (locaux). Emerveillement sur la complexité de l'homme, de la vie, pas justifié : 4 milliards d'années d'évolution. Si la vie n'était pas bien organisée, nous ne pourrions pas le savoir (principe anthropique faible de l'astrophysique ; principe anthropique fort expliqué par la sélection naturelle). | |
| − | : | + | |
| + | Ainsi la sélection naturelle peut-elle justifier certaines théories sur la finalité de la nature, qui restent ainsi valables même si leur fondement est faux. | ||
| + | Ex : la nature est prévoyante, mais en fait disparition des espèces non adaptées. Différence =pas prévoyante pour tout le monde, mais le fait que la nature cherche toujours la meilleure solution reste vrai. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
}}<!--***Fin Fiche Stratégie de changement conceptuelle (Solutions possibles)***--> | }}<!--***Fin Fiche Stratégie de changement conceptuelle (Solutions possibles)***--> | ||
| Ligne 326 : | Ligne 359 : | ||
<!-- ************ Commercez les modifications *********************--> | <!-- ************ Commercez les modifications *********************--> | ||
| − | * [[ | + | * [[Qu'est ce que le finalisme ?]] |
| − | * [[ | + | * [[Qui sont les principaux penseurs finalistes ?]] |
| − | * [[ | + | * [[Quelles sont les courants de pensées liés au finalisme ?]] |
| + | * [[Quelles sont les courants de pensées opposés au finalisme ?]] | ||
| + | * [[Quelle est la différence entre finalisme et efficience?]] | ||
| + | * [[Quelle est la relation entre causalité et finalité ?]] | ||
| + | * [[Quelles sont les courants de pensées domaines influencés par le finalisme ?]] | ||
| + | * [[Quelles sont les limites du finalisme ?]] | ||
| + | * [[Jusqu'à quel point s'accord le finalisme et le créationnisme ?]] | ||
| + | * [[Quelle est la relation entre finalisme et téléologie ?]] | ||
| + | * [[Comment influence le hasard sur le finalisme ?]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* --> | }}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* --> | ||
| Ligne 340 : | Ligne 388 : | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications *********************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications *********************--> | ||
| − | * ....... | + | *https://journals.openedition.org/philosant/577 |
| − | * ......... | + | |
| − | * ... | + | *https://www.pourlascience.fr/sd/histoire-sciences/un-finalisme-tempere-3912.php |
| − | * .. | + | |
| + | *https://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1972_num_41_2_1674 | ||
| + | |||
| + | *https://fr.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9ologie | ||
| + | |||
| + | *http://spinozaetnous.org/wiki/Finalisme | ||
| + | |||
| + | *http://www.yann-ollivier.org/philo/Selection_naturelle_et_finalisme | ||
| + | |||
| + | *https://www.aquaportail.com/definition-3538-finalisme.html | ||
| + | |||
| + | *http://www.educ-revues.fr/ARGOS/AffichageDocument.aspx?iddoc=32307 | ||
| + | |||
| + | *https://www.maxicours.com/se/cours/y-a-t-il-une-science-du-vivant/ | ||
| + | |||
}}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** --> | }}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** --> | ||
{{Widget:Fiche-Conceptions-Bas}} | {{Widget:Fiche-Conceptions-Bas}} | ||
Version actuelle datée du 9 juin 2020 à 14:41
 Conception : Clarification - Explicitation
Conception : Clarification - Explicitation
Finalisme
Quelques définitions
PHILOS. Système de pensée qui admet la finalité comme principe d'explication des phénomènes dans l'univers en général ou dans un domaine limité. Finalisme radical; finalisme chrétien (V. final ex. 2).Mécanisme et finalisme sont trop loin l'un de l'autre (Bergson, Évol. créatr.,1907, p. 92): Les prophètes juifs, suivant leur idée que les révolutions des empires n'ont qu'un but, l'accomplissement des volontés de Iahvé sur Israël, sont (...) les fondateurs de la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire de la tentative d'assujettir tous les événements à un finalisme providentiel. Renan, Hist. peuple Isr.,t. 3, 1891, p. 468. Prononc. : [finalism̥]. Étymol. et Hist. 1890 (Renan, Avenir sc., p. 258).
- Le finalisme est aussi appelé la théorie des causes finales. Il est une conception selon laquelle toute évolution est conditionnée par, ou contient en elle, la réalisation d'un but fixé d'avance: l'oiseau est fait pour voler, l'évolution des reptiles aux oiseaux a été conduite vers, et par, la réalisation du vol.
- Il fait donc intervenir une (ou des) force(s) transcendantale(s) à la matière et à la vie, celles-ci déterminent la progression vers le but. Le finalisme est surtout admis en théologie mais est très controversée en biologie, quoique certains concepts en évolutionnisme rejoignent ces théories, notamment le néo-darwinisme.
- C' est une théorie qui estime plausible l'existence d'une cause finale de l'univers, de la nature ou de l'humanité. Elle présuppose un dessein, un but, une signification, immanents ou transcendants, présents dès leur origine. Le finalisme se retrouve souvent dans l'évocation de processus d'évolution biologique, dont le but serait par exemple l'apparition de l'espèce humaine.
- En raison du principe de l'antériorité (au moins logique, sinon chronologique) de la cause par rapport à ses effets, la question des causes finales à l'œuvre dans la nature touche de près à celle de l'existence de Dieu ; c'est pourquoi elle est si débattue. Le problème du finalisme et du déterminisme se pose dès l'Antiquité, dans les mêmes termes à peu près où il se pose encore aujourd'hui. Aristote a présenté les deux options possibles dans sa Physique. D'abord la position mécaniste, pour laquelle tout s'explique par les causes efficientes ou, si l'on préfère, par les lois aveugles de la nature. Leur combinaison aboutit accidentellement au monde naturel tel que nous le voyons :
« Qui empêche, dit-on, que la nature agisse sans avoir de but (...) ? Jupiter (...) ne fait pas pleuvoir pour développer et nourrir le grain ; mais il pleut par une loi nécessaire ; car, en s'élevant, la vapeur doit se refroidir ; et la vapeur refroidie, devenant de l'eau, doit nécessairement retomber. Que si ce phénomène ayant lieu, le froment en profite pour germer et croître, c'est un simple accident. (...) Qui empêche de dire également que dans la nature les organes corporels eux-mêmes sont soumis à la même loi, et que les dents, par exemple, poussent nécessairement, celles de devant, incisives et capables de déchirer les aliments, et les molaires, larges et propres à les broyer, bien que ce ne soit pas en vue de cette fonction qu'elles aient été faites, et que ce soit une simple coïncidence ? » (Aristote, Physique, II, 8)
- Les êtres naturels s'expliquent ainsi par le hasard et la nécessité, plus précisément par la naissance aléatoire des formes naturelles et la sélection des seules qui sont viables :
« Ainsi donc, toutes les fois que les choses se produisent accidentellement comme elles se seraient produites en ayant un but, elles subsistent et se conservent, parce qu'elles ont pris spontanément la condition convenable ; mais celles où il en est autrement périssent ou ont péri. » (Ibid. ; cet évolutionnisme rudimentaire est celui d'Empédocle.)
- La position d'Aristote est donc en retrait[En quoi ?] sur celle de Socrate et de Platon (cf. le Timée), car il n'attribue pas la finalité à un Démiurge auteur, ni même organisateur de la nature. Son finalisme n'est pas intentionnel mais immanent.
- Le finalisme a été critiqué avant et après Aristote par les matérialistes tels qu'Empédocle, Démocrite, Épicure ou Lucrèce : expliquer les phénomènes par leur fin paraît en effet contraire au bon sens, puisqu'une cause précède ses effets. Ainsi pour Lucrèce, ce n'est pas la fonction qui crée l'organe, mais l'organe qui crée la fonction ; ce n'est pas la vue qui fait que l'on a des yeux, mais les yeux qui permettent la vue :
« Les yeux n’ont pas été créés, comme tu pourrais le croire, pour nous permettre de voir au loin ; ce n’est pas davantage pour nous permettre de marcher à grands pas que l’extrémité des jambes et des cuisses s’appuie et s’articule sur les pieds ; non plus que les bras que nous avons attachés à de solides épaules, les mains qui nous servent des deux côtés ne nous ont été donnés pour subvenir à nos besoins. Interpréter les faits de cette façon, c’est faire un raisonnement qui renverse l’ordre des choses : c’est mettre partout la cause après l’effet. Aucun organe de notre corps, en effet, n' a été créé pour notre usage, mais c’est l’organe qui crée l’usage. La vision n’existait pas avant la naissance des yeux, non plus que la parole avant la création de la langue : c’est bien plutôt l’existence de la langue qui a précédé de loin la parole et les oreilles existaient bien avant que ne fût entendu un son. En bref, tous les organes, à mon avis, existèrent avant qu’on en fît usage. Ils n’ont donc pas pu être créés en vue de leur fonction. » (Lucrèce, De Natura rerum, IV, v. 824-842)
- Aux mécanistes, l'explication par les fins paraît donc une faute logique, une inversion de l'effet et de la cause qu'on peut illustrer par cette boutade attribuée à Henry Monnier : « La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie sachant que c'est la région où l'on boit le plus de cidre. ».
- Aristote définit dans la recherche des causes la cause finale, qui est un but à atteindre. Le but (la fin) poursuivi devient la cause première, le début et non la fin de la chaîne. Elle est associée à une pensée consciente, intelligente, attribuée à la divinité créatrice. Le finalisme est donc l’idée que les choses se produisent à cause du but à atteindre. Cela va à l’encontre du mécanisme, soutenu par Descartes, qui se base sur des relations de cause à effet limitées au monde physique et exclue ainsi la considération des fins.
Un terme connexe est la téléologie, définie comme la prise en compte du but, qui est tenu pour déterminant dans la séquence des évènements.
La finalité est la réponse à la question pourquoi, par opposition au comment. Rechercher une finalité aux choses qui nous entourent semble être une tendance qui nous est naturelle, à nous animaux entourés d’objets que nous avons conçus et construits pour un usage précis.
- Ce finalisme ainsi défini par analogie avec nos machines appelle l’idée d’un concepteur, d’un ingénieur, lorsqu’on pousse l’analogie.
Ainsi le finalisme est à manier avec précaution en sciences. C’est un terme qu’on évite parce qu’il est suspect d’être associé à une croyance en une fin transcendante, donc à une divinité.
Or éviter le recours à la finalité obscurcit nos explications car la finalité des êtres vivants saute aux yeux : l’œil est fait pour voir, le cœur pour mettre en mouvement le sang, le poisson pour nager. Les êtres vivants apparaissent finalisés grâce à l’adéquation entre les structures et les fonctions qu’elles remplissent. L’illusion de finalité est donc dans l’adaptation.
Se poser la question de la finalité dans le vivant est utile, en physiologie par exemple : on ne peut comprendre le rôle d’un organe sans subordonner sa fonction à un but, comme Claude Bernard l’a montré. La fonction glycogénique du foie se comprend dans le cadre du maintien du milieu intérieur.
Nous sommes donc face à une alternative compliquée : contourner consciencieusement toute finalité et perdre un outil de compréhension de la fonction ou ouvrir la porte à l’idée d’un ingénieur qui a conçu les êtres vivants.
Kant donne une solution dans La critique de la faculté de juger : il ne faut pas se passer de la compréhension de la fonction d’une structure que nous apporte l’idée d’une fin, mais cela ne nous autorise pas à dire que la nature a créé cette structure dans le but de remplir cette fonction.
Pour Claude Bernard, "le physicien et le chimiste peuvent repousser toute idée de causes finales dans les faits qu’ils observent, tandis que le physiologiste est porté à admettre une finalité harmonique et préétablie dans le corps organisé dont toutes les actions solidaires et génératrices les unes aux autres " (dans l’introduction à la médecine expérimentale, souligné par P. H. Gouyon, J. P. Henry, J. Arnould dans les avatars du gène).
Un autre terme a été popularisé par Jacques Monod, pour éviter le terme de téléologie : la téléonomie, qu’il définit comme la propriété des êtres vivant d’être doués de projet. Ce projet peut se résumer simplement à se reproduire : « Le rêve de toute cellule : devenir deux cellules », comme le dit François Jacob.
La solution est donc la suivante : la finalité peut s’étudier au sein de l’organisme. Chaque organe remplit une fonction qui permet que l’organisme, communauté d’organes, puisse un jour se reproduire. Cette finalité s’inscrit dans le présent : l’organe remplit sa fonction ici et maintenant.
Il n’est pas approprié d’étendre cette finalité au-delà de l’organisme et dans le temps, dans un finalisme qui transcende l’organisme et les générations, en tendant vers une fin future, et qui n’est donc pas compatible avec la science, celle-ci se devant de rejeter par postulat tout projet transcendant la matière et la vie. Elle se doit d’être objective et ne peut raisonner en termes de cause finale.
- Le finalisme au contraire suppose un projet déjà inscrit, dés l’apparition de la vie, voire dés le début de l’Univers comme chez Teilhard de Chardin. L’évolution est alors une révélation de ce projet.
Cette conception a souvent dérivé d’une analogie entre évolution et développement embryonnaire. C’est d’ailleurs de là que vient l’emploi du mot évolution, introduit au départ par Spencer et refusé par Darwin qui voyait bien l’implication de ce mot qui indique quelque chose qui se déroule, se déploie comme un plan. Spencer étend les lois du développement à d’autres domaines et affirme une loi de progrès qui est le passage de l’homogène à l’hétérogène, donc du simple au complexe. Les lois de l’embryologie servent de modèle à des lois qui s’appliquent à l’ensemble de l’Univers.
On retrouve cela dans le principe anthropique au XXème siècle qui part du constat que dés la naissance de l’Univers commence une succession événements improbables, sans lesquels l’Univers ne serait pas ce qu’il est donc sans lesquels nous ne serions pas là. Le principe anthropique admet qu’il fallait que nous soyons là, et donc que tous ces événements improbables se sont produits dans ce but. La fin (notre existence) est donc la cause.
On voit que presque inévitablement l’aboutissement supposé du projet est l’Homme, et cela nous ramène à notre anthropocentrisme. Dans la pensée d’Aristote sur les causes finales, c’est la fonction qui est à l’origine de l’organe. Le Créateur le conçoit pour qu’il remplisse au mieux cette fonction.
Si les êtres vivants apparaissent être l’expression d’une finalité, ce n’est pas lié à une intention qui leur est extérieure, mais cela correspond à un processus, avec le jeu du couple hasard/sélection. Le hasard des mutations fait apparaître des nouveautés. Dans ce sens la science donne tort à Aristote car cela se fait au hasard : la mutation n’est pas orientée vers un but. Ensuite il y a finalisation sous l’effet de la sélection. Ici on donne partiellement raison à Aristote : la structure est façonnée pour remplir une fonction. Mais c’est la sélection qui le fait.L’évolution est une une amélioration permanente et discrète
Discussion du finalisme à l'époque moderne
- C'est donc sur le finalisme que repose l'argument classique en faveur de l'existence de Dieu fondé sur l'ordre du monde, qui met pour une fois Bossuet et Voltaire d'accord. Le premier écrivait :
« Tout ce qui montre de l'ordre, des proportions bien prises et des moyens propres à faire de certains effets, montre aussi une fin expresse : par conséquent, un dessein formé, une intelligence réglée et un art parfait. C'est ce qui se remarque dans toute la nature. Nous voyons tant de justesse dans ses mouvements, et tant de convenance entre ses parties, que nous ne pouvons nier qu'il n'y ait de l'art. Car s'il en faut pour remarquer ce concert et cette justesse, à plus forte raison pour l'établir. C'est pourquoi nous ne voyons rien, dans l'univers, que nous ne soyons portés à demander pourquoi il se fait : tant nous sentons naturellement que tout a sa convenance et sa fin. » (De la Connaissance de Dieu et de soi-même, IV, 1) L'ordre, c'est-à-dire la convenance réciproque des différents éléments d'un ensemble, peut être défini en effet comme une finalité interne à ce qui est ordonné. L'horloger qui fabrique deux engrenages A et B destinés à fonctionner ensemble les fabrique l'un pour l'autre. L'engrenage B est présent à sa pensée pendant qu'il fabrique le A, comme cause finale de la forme de ce dernier. Donc le bon fonctionnement commun des engrenages A et B suppose la pensée d'un horloger. De même, puisque l'ordonnancement des différents éléments naturels présente une apparence « d'art », il suggère l'idée d'un artisan, d'où les vers de Voltaire :
« Il est vrai, j'ai raillé Saint-Médard et la bulle, Mais j'ai sur la nature encor quelque scrupule. L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. » (Voltaire, Les Cabales)
Toutefois, Spinoza a critiqué le finalisme au XVIIe s. notamment dans l'appendice à la première partie de l'Éthique, par un argument propre à sa philosophie selon laquelle le monde et l'être suprême ne se distinguent pas : si l'être suprême poursuivait des finalités, alors il ne serait pas suprême. En effet, l'être suprême est absolument infini or seul un être fini ne se suffit pas à lui-même et doit donc chercher hors de son état initial ce qui serait susceptible de le compléter. Par ailleurs, ce philosophe se propose aussi d'expliquer les causes de la croyance selon laquelle des finalités qui nous dépassent seraient à l'œuvre dans la nature : c'est par ignorance des causes réelles qui déterminent les phénomènes naturels et parce qu'ils se connaissent uniquement comme cherchant ce qui leur est utile, que les hommes croient connaître quelque chose quand ils en ont imaginé une cause finale. Le finalisme repose sur l'idée qu'il existerait une volonté comparable à celle de l'homme ayant organisé toutes choses dans la nature pour son utilité. Or tout ce qui existe dans la nature n'existe qu'en tant que façon d'être de Dieu, autrement dit mode de la substance absolument infinie. Rien ne peut donc être déterminé par des causes finales. Autrement ce serait considérer Dieu comme imparfait, manquant de quelque chose puisqu'il aurait besoin de la réalisation de ces fins pour son utilité.
Science et finalisme
- La finalité extrinsèque vise à rendre compte de l'adéquation des êtres naturels entre eux. Elle peut aboutir à un finalisme simpliste, que Bernardin de Saint-Pierre a exprimé de la manière la plus naïve et caricaturale :
« Il n’y a pas moins de convenance dans les formes et les grosseurs des fruits. Il y en a beaucoup qui sont taillés pour la bouche de l'homme, comme les cerises et les prunes ; d’autres pour sa main, comme les poires et les pommes ; d’autres beaucoup plus gros comme les melons, sont divisés par côtes et semblent destinés à être mangés en famille : il y en a même aux Indes, comme le jacq, et chez nous, la citrouille qu’on pourrait partager avec ses voisins. La nature paraît avoir suivi les mêmes proportions dans les diverses grosseurs des fruits destinés à nourrir l'homme, que dans la grandeur des feuilles qui devaient lui donner de l’ombre dans les pays chauds ; car elle y en a taillé pour abriter une seule personne, une famille entière, et tous les habitants du même hameau. » (Études de la nature, ch. XI, sec. Harmonies végétales des plantes avec l'homme, 1784). En 1759, Voltaire se moque de ce type de finalisme et en particulier de Leibniz (dont la vision des choses est évidemment plus subtile) dans Candide (chapitre I) :
« Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y a point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles. « Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement : car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes ; aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux ; aussi monseigneur a un très-beau château : le plus grand baron de la province doit être le mieux logé ; et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l’année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise : il fallait dire que tout est au mieux. » » Pierre Teilhard de Chardin, par exemple, est en quelque manière l'héritier de cette conception. Son finalisme religieux conçoit l'évolution de l'univers comme un mouvement ascendant et convergent de la nature vers Dieu en passant par l'homme. Dans sa théorie, contrairement à l'option mécaniste, l'humanité n'est pas issue du hasard, mais d'un dessein intelligent à l'œuvre dans l'évolution. La fin selon Teilhard est l'avènement du « Christ Cosmique » au « Point Oméga ». Teilhard de Chardin n'est pas pour autant un adversaire de l'évolutionnisme (dont il est en fait inspiré, tout comme Bergson), mais seulement de l'idée d'après laquelle ses résultats sont purement accidentels.
Le principe anthropique repose aussi sur la considération de la finalité extrinsèque, en ce sens que l'apparition de la vie et, plus tard, celle de l'homme, suppose un ajustement fin des constantes universelles.
- La finalité intrinsèque est en rapport avec l'organisation interne des êtres vivants, organisation qui leur permet de persister dans l'être et d'agir par un concours ordonné de causalités intérieures. C'est pourquoi la biologie est aujourd'hui le principal champ de bataille opposant finalistes et mécanistes.
![]() Conceptions erronées et origines possibles
Conceptions erronées et origines possibles
- confondre finalisme et efficience( or la cause efficiente est le contraire de la cause finale )
- Dogme finaliste :vouloir tout expliquer par le finalisme
- vouloir expliquer un tel fonctionnement dans la nature susceptible à être fini à tout moment tout en rejetant la conception finaliste.
- admettre que le finalisme est étranger aux préoccupations scientifiques de notre temps. La science ne recherche pas les causes finales. Son domaine est le déterminisme, non le finalisme.
- confusion entre finalisme et créationnisme : cherchent, l'un comme l'autre, à s'accaparer quelque chose du domaine de la science.
Les contradictions du finalisme
Le problème du finalisme et du déterminisme
se pose dès l'Antiquité, dans les mêmes termes à peu près où il se pose encore aujourd'hui. Aristote a présenté les deux options possibles dans sa Physique. D'abord la position mécaniste, pour laquelle tout s'explique par les causes efficientes ou, si l'on préfère, par les lois aveugles de la nature. Leur combinaison aboutit accidentellement au monde naturel tel que nous le voyons :
« Qui empêche, dit-on, que la nature agisse sans avoir de but (...) ? Jupiter (...) ne fait pas pleuvoir pour développer et nourrir le grain ; mais il pleut par une loi nécessaire ; car, en s'élevant, la vapeur doit se refroidir ; et la vapeur refroidie, devenant de l'eau, doit nécessairement retomber. Que si ce phénomène ayant lieu, le froment en profite pour germer et croître, c'est un simple accident. (...) Qui empêche de dire également que dans la nature les organes corporels eux-mêmes sont soumis à la même loi, et que les dents, par exemple, poussent nécessairement, celles de devant, incisives et capables de déchirer les aliments, et les molaires, larges et propres à les broyer, bien que ce ne soit pas en vue de cette fonction qu'elles aient été faites, et que ce soit une simple coïncidence ? » (Aristote, Physique, II, 8)
- Les êtres naturels s'expliquent ainsi par le hasard et la nécessité, plus précisément par la naissance aléatoire des formes naturelles et la sélection des seules qui sont viables :
« Ainsi donc, toutes les fois que les choses se produisent accidentellement comme elles se seraient produites en ayant un but, elles subsistent et se conservent, parce qu'elles ont pris spontanément la condition convenable ; mais celles où il en est autrement périssent ou ont péri. » (Ibid. ; cet évolutionnisme rudimentaire est celui d'Empédocle.)
- Pourtant, Aristote critique ce point de vue aussitôt après l'avoir exposé, et adopte une position finaliste. L'idée de finalité lui semble s'imposer du fait de la régularité des phénomènes naturels. En effet, leur répétition suppose un ordre des natures, tandis que le hasard ne produit que des coïncidences fortuites : le hasard peut faire tomber un dé plusieurs fois successivement sur le six, mais si ce chiffre sort systématiquement, on en conclura nécessairement que le dé est pipé, c'est-à-dire « étudié pour » aboutir à ce résultat. De même dans la nature, où l'intelligence peut distinguer entre les coïncidences fortuites et les phénomènes qui se produisent systématiquement :
« On ne trouve point que ce soit un hasard ni une chose accidentelle qu'il pleuve fréquemment en hiver ; mais c'est un hasard, au contraire, s'il pleut quand le soleil est dans la constellation du chien. Ce n'est pas davantage un hasard qu'il y ait de grandes chaleurs durant la canicule ; mais c'en est un qu'il y en ait en hiver. (…) On entend par choses naturelles toutes celles qui, mues continûment par un principe qui leur est intime, arrivent à une certaine fin. De chacun de ces principes, ne sort pas pour chaque espèce de chose un résultat identique, de même qu'il n'en sort pas un résultat arbitraire ; mais toujours le principe tend au même résultat, à moins d'obstacle qui l'arrête. (…) Quand c'est toujours ou du moins le plus ordinairement qu'une chose arrive, ce n'est plus ni par accident ni par hasard ; or, dans la nature, les choses se produisent éternellement de la même façon, si rien ne s'y oppose. » (Ibid.)
- Le finalisme d'Aristote est une application de sa théorie des quatre causes de la substance : Pour lui, il n'y a pas lieu d'opposer causes efficientes et cause finale : celles-là sont subordonnées à celle-ci, comme des moyens mis en œuvre pour arriver à un but. La fin qu'on observe dans la nature en dernière analyse, c'est la conservation des formes naturelles : « La forme étant une fin, et tout le reste s'ordonnant en vue de la fin et du but, on peut dire que la forme est le pourquoi des choses et leur cause finale. » (Ibid.) Il s'agit donc d'une finalité immanente à la nature, laquelle œuvre ainsi à sa propre conservation. Il n'y a pas de créateur, mais seulement un « Premier moteur » qui meut l'univers tout entier en tant que cause finale ultime.
- La position d'Aristote est donc en retrait[En quoi ?] sur celle de Socrate et de Platon (cf. le Timée), car il n'attribue pas la finalité à un Démiurge auteur, ni même organisateur de la nature. Son finalisme n'est pas intentionnel mais immanent.
Le finalisme a été critiqué avant et après Aristote par les matérialistes
tels qu'Empédocle, Démocrite, Épicure ou Lucrèce : expliquer les phénomènes par leur fin paraît en effet contraire au bon sens, puisqu'une cause précède ses effets. Ainsi pour Lucrèce, ce n'est pas la fonction qui crée l'organe, mais l'organe qui crée la fonction ; ce n'est pas la vue qui fait que l'on a des yeux, mais les yeux qui permettent la vue :
« Les yeux n’ont pas été créés, comme tu pourrais le croire, pour nous permettre de voir au loin ; ce n’est pas davantage pour nous permettre de marcher à grands pas que l’extrémité des jambes et des cuisses s’appuie et s’articule sur les pieds ; non plus que les bras que nous avons attachés à de solides épaules, les mains qui nous servent des deux côtés ne nous ont été donnés pour subvenir à nos besoins. Interpréter les faits de cette façon, c’est faire un raisonnement qui renverse l’ordre des choses : c’est mettre partout la cause après l’effet. Aucun organe de notre corps, en effet, n' a été créé pour notre usage, mais c’est l’organe qui crée l’usage. La vision n’existait pas avant la naissance des yeux, non plus que la parole avant la création de la langue : c’est bien plutôt l’existence de la langue qui a précédé de loin la parole et les oreilles existaient bien avant que ne fût entendu un son. En bref, tous les organes, à mon avis, existèrent avant qu’on en fît usage. Ils n’ont donc pas pu être créés en vue de leur fonction. » (Lucrèce, De Natura rerum, IV, v. 824-842)
- Aux mécanistes, l'explication par les fins paraît donc une faute logique, une inversion de l'effet et de la cause qu'on peut illustrer par cette boutade attribuée à Henry Monnier : « La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie sachant que c'est la région où l'on boit le plus de cidre. ».
- Nourrie d'Aristote, la philosophie scolastique, représentée notamment par Thomas d'Aquin, répond à l'objection mécaniste par le moyen de la formule « Finis est prima in intentione, ultima in executione », qui concilie déterminisme et finalisme: la fin est première dans l'intention, ultime dans l'exécution. Ultime dans l'exécution : c'est bien parce que les éléments qui forment l'œil sont disposés de manière adéquate qu'il y a vue (déterminisme). Première dans l'intention : la structure de l'œil et son adéquation à la nature de la lumière supposent une intention ordonnatrice, et donc une Pensée préalable (finalisme), car ce n'est qu'en tant que conçue que la fin peut être une cause antérieure à ses effets.
- Il est quasi universellement admis que le finalisme est étranger aux préoccupations scientifiques de notre temps. La science ne recherche pas les causes finales. Son domaine est le déterminisme, non le finalisme. Ainsi, la sélection naturelle (surtout complétée par les acquis de la génétique) décrit et explique au niveau scientifique le processus d'évolution. Mais la science n'étant pas le seul mode légitime de connaissance, la question de la finalité est encore débattue sur le plan philosophique. Le fait que la science ne s'intéresse pas aux causes finales ne prouve ni l'existence ni l'inexistence d'une cause finale ; la science ne répond pas à cette question car elle ne se la pose pas.
La confusion entre les deux niveaux - aussi légitimes l'un que l'autre mais qui doivent être distingués ; voir par exemple la distinction célèbre de Dilthey entre sciences de l'esprit et sciences de la nature (explicatives) et sciences de l'esprit (compréhensives) - est à l'origine de bien des errements, entre autres dans le débat sur l'intelligent design, théorie dont la scientificité est douteuse. Mais la science n'a pas vocation à répondre aux questions ultimes, dont celle de la finalité fait partie ; c'est du moins le point de vue de Kant dans la Critique de la raison pure, lorsqu'il affirme une séparation complète de la métaphysique et des sciences empiriques.
Le finalisme rejeté avec vigueur par les évolutionnistes darwiniens
celui qui associe l’apparition d’un organe à un plan, à une intention.
le finalisme est incompatible avec le panthéisme
si le fonctionnement et le développement de l'univers s'expliquent par une pensée suprême recherchant des effets, il faut qu'elle soit transcendante (et non immanente) à celui-ci, visant des fins pour l'univers et non pour elle-même.
- On ne saurait mieux combiner :
1°) un finalisme méthodologique dans l’ordre de la connaissance, qui prétend expliquer suffisamment un phénomène en en donnant une justification par une cause finale ;
2°) un finalisme métaphysique et théologique, doublé d’un anthropocentrisme, qui prend l’allure d’un providentialisme, puisque l’objet de l’enquête est bien l’intention du démiurge ;
3°) une perspective téléologique qui assigne à la créature,l’homme ici, un but à atteindre, voire une mission à accomplir, en l’occurrence la philosophie et l’hommage aux dieux.
Un tel texte, à l’évidence, tombe éminemment sous la critique spinoziste et ne saurait prétendre à une valeur épistémologique.
Le créationnisme et le finalisme évolutionniste
cherchent, l'un comme l'autre, à s'accaparer quelque chose du domaine de la science. Pour le créationnisme, il importe de maintenir le mythe de la création comme l'unique source de savoir sur les origines. Pour le finalisme évolutionniste, l'essentiel est de donner un sens religieux au savoir scientifique.
Mais le pédagogue doit-il prendre en compte ces deux représentations pour élaborer son enseignement ? Assurément, si l'objectif est de clarifier ce qui relève de la science et ce qui relève de la religion.
Par exemple, quand un élève affirme que l'homme n'est pas un animal, il renonce à sa fusion affective avec la nature. Cette séparation, condition nécessaire pour mener à bien une observation raisonnée sur le vivant, n'est pas pour autant suffisante pour engager un processus de décentration, c'est-à-dire renoncer à l'anthropocentrisme. Le travail pédagogique ne peut donc se limiter à rappeler que la vie s'est développée sur Terre depuis plus de trois milliards d'années sans la présence de l'homme. Une telle présentation peut même renforcer l'idée selon laquelle l'homme est l'accomplissement de l'évolution, et que jamais il ne connaîtra d'extinction.
Dans la pensée religieuse, l'histoire est conçue comme la perspective d'un projet transcendantal (finalité a priori), tandis qu'en biologie de l'évolution, elle est décrite comme une rétrospective, intelligible uniquement en termes de mécanismes naturels (finalité a posteriori ou téléonomie) sans préciser ni direction ni but.
Ne pas reconnaître cette différence de registre, c'est donner droit de citer au créationnisme, c'est subordonner les faits historiques à une possible interprétation religieuse. C'est confondre le déterminisme biologique de la sélection naturelle avec un finalisme historico-religieux. Enfin, c'est prendre le risque de laisser croire, à tort, qu'il existe une concurrence explicative sur l'origine et l'histoire du vivant entre science et religion .
![]() Conceptions: Origines possibles
Conceptions: Origines possibles
La doctrine finaliste
Aristote proposait une explication finaliste des mécanismes de la vie ; le finalisme établit que « la nature ne fait rien en vain ». Rien dans ce que produit la nature n’est inutile ; celle-ci a donc une « finalité », c’est-à-dire un but, un dessein. Lorsque Lamarck dit que « la fonction crée l’organe », il soutient, d’une certaine manière, l'idée de finalisme. « C’est à partir des fins liées à certaines fonctions des organes que l’on peut comprendre le vivant », pense Lamarck. Par exemple, l’œil est fait pour voir, l’oreille pour entendre, les mains pour se saisir des objets. Les oiseaux ont des ailes pour voler, les poissons ont des nageoires pour nager.
Croire que « la nature ne fait rien en vain » n’empêche pas de défendre, conjointement, la spécificité de la vie. Ainsi à la doctrine mécaniste de la vie, défendue par les cartésiens, s’oppose la doctrine vitaliste, défendue par les biologistes.
- Pourtant, Aristote critique ce point de vue aussitôt après l'avoir exposé, et adopte une position finaliste. L'idée de finalité lui semble s'imposer du fait de la régularité des phénomènes naturels. En effet, leur répétition suppose un ordre des natures, tandis que le hasard ne produit que des coïncidences fortuites : le hasard peut faire tomber un dé plusieurs fois successivement sur le six, mais si ce chiffre sort systématiquement, on en conclura nécessairement que le dé est pipé, c'est-à-dire « étudié pour » aboutir à ce résultat. De même dans la nature, où l'intelligence peut distinguer entre les coïncidences fortuites et les phénomènes qui se produisent systématiquement :
« On ne trouve point que ce soit un hasard ni une chose accidentelle qu'il pleuve fréquemment en hiver ; mais c'est un hasard, au contraire, s'il pleut quand le soleil est dans la constellation du chien. Ce n'est pas davantage un hasard qu'il y ait de grandes chaleurs durant la canicule ; mais c'en est un qu'il y en ait en hiver. (…) On entend par choses naturelles toutes celles qui, mues continûment par un principe qui leur est intime, arrivent à une certaine fin. De chacun de ces principes, ne sort pas pour chaque espèce de chose un résultat identique, de même qu'il n'en sort pas un résultat arbitraire ; mais toujours le principe tend au même résultat, à moins d'obstacle qui l'arrête. (…) Quand c'est toujours ou du moins le plus ordinairement qu'une chose arrive, ce n'est plus ni par accident ni par hasard ; or, dans la nature, les choses se produisent éternellement de la même façon, si rien ne s'y oppose. » (Ibid.)
Le primat des causes finales
Lorsque Aristote analyse la production, il distingue quatre causes, la cause matérielle, la cause efficiente, la cause finale et la cause formelle : « Tout ce qui devient, devient, par quelque chose et à partir de quelque chose, quelque chose » (Métaphysique) Que la production soit naturelle ou artificielle, elle suppose la mise en jeu d'une matière, ou cause matérielle (« à partir de quelque chose »), d'un agent ou cause efficiente (« par quelque chose ») et de la forme et de la finalité du produit, ou cause formelle et cause finale (« quelque chose »).
Prenons pour exemple une statue :
-la cause matérielle est le marbre
-la cause efficiente est le sculpteur
-la cause formelle est la configuration de la statue
-la cause finale est ce en vue de quoi est faite la statue (sa destination)
¤Le primat de la cause finale implique que celui qui a la meilleure connaissance de la selle c'est le cavalier et non l'artisan. Au niveau de l'homme, la cause matérielle est constituée du sang, des os, de la chair etc., la cause efficiente est un autre homme, la cause formelle est sa forme d'homme, la cause finale est de perpétuer l'espèce et entrer en rapport avec Dieu. Les causes ici sont mêlées. La science s'occupe des trois premières causes mais la métaphysique étudie la cause finale, plus difficile et plus importante. La philosophie d'Aristote est donc un finalisme.
- Le finalisme d'Aristote est une application de sa théorie des quatre causes de la substance : Pour lui, il n'y a pas lieu d'opposer causes efficientes et cause finale : celles-là sont subordonnées à celle-ci, comme des moyens mis en œuvre pour arriver à un but. La fin qu'on observe dans la nature en dernière analyse, c'est la conservation des formes naturelles : « La forme étant une fin, et tout le reste s'ordonnant en vue de la fin et du but, on peut dire que la forme est le pourquoi des choses et leur cause finale. » (Ibid.) Il s'agit donc d'une finalité immanente à la nature, laquelle œuvre ainsi à sa propre conservation.Il n'y a pas de créateur, mais seulement un « Premier moteur » qui meut l'univers tout entier en tant que cause finale ultime.
 Conceptions liées - Typologie
Conceptions liées - Typologie
 Concepts ou notions associés
Concepts ou notions associés
Nature / Vie / Biologie / Finalité / Causalité / Efficience / Religion / Dieu / Perspective téléologique / Zoologie /
| Références
| |||
|---|---|---|---|
|
Sur le Portail Questions / Réponses |
Sur Portail de Formation Gratuite |
Sur des sites de Formation |
Sur DidaQuest |
| Finalisme sur : Wikipedia / Wikiwand / Universalis / Larousse encyclopédie / Khan Académie | |||
| Sur Wikiwand : | |||
| Sur Wikipédia : | |||
| Sur Wikiversity : | |||
| Sur Universalis : | |||
| Sur Khan Académie : | |||
 Éléments graphique
Éléments graphique
 Stratégie de changement conceptuel
Stratégie de changement conceptuel
Quelques stratégies
- Il sera judicieux de montrer l'apport de cette doctrine dans la compréhension de l'histoire des sciences tout en référant à des textes et des études .
- étudier cette doctrine en parallèle avec l'épistémologie pour comprendre les causes de sa naissance .
- Il est nécessaire de montrer les limites de ce courant de pensée à partir des exemples ainsi que son influence sur l'histoire des sciences.
- Aborder les courants de pensée en concordance avec le finalisme pou bien l' expliquer .
- Aborder les courant de pensés qui sont en discordance avec le finalisme .
- Organiser des débats scientifiques sur les apport-limites du finalisme
- Laisser les élèves s'exprimer :état de dévolution,intervenir, poser des questions, interagir, chercher des argumentations ,et rectifier les conceptions
en relation avec causalité et finalité
- Apprendre par socio-cognitif: interactions Élève-Élève et Élève-Enseignant.
- utiliser la problématisation.
- Appliquer divers médiations didactiques pour traiter ce sujet .
- Aider l'élève à prendre conscience que sa conception de l'histoire de la vie est intimement liée à son champ de croyances, c'est l'aider à un travail de distanciation sur son propre référentiel de convictions. C'est aussi intégrer que biologie de l'évolution et religion n'ont pas le même regard sur la nature. Il s'agit, en réalité, de deux visions culturelles de la nature. Là où la science satisfait un besoin de connaissances, la religion répond, quant à elle, à un besoin de justification de l'existence de l'univers, de la Terre, de la vie. La reconnaissance de cette dualité irréductible entre science et religion est, en soi, un objectif pédagogique.
Néanmoins, l'action pédagogique n'a pas à exclure d'autres approches de la nature : religieuse, artistique, philosophique, etc., ni vocation à opposer biologie de l'évolution et religion, mais à préciser que toutes deux appartiennent à des registres de pensée différents.
Dans la pensée religieuse, l'histoire est conçue comme la perspective d'un projet transcendantal (finalité a priori), tandis qu'en biologie de l'évolution, elle est décrite comme une rétrospective, intelligible uniquement en termes de mécanismes naturels (finalité a posteriori ou téléonomie) sans préciser ni direction ni but.
Ne pas reconnaître cette différence de registre, c'est donner droit de citer au créationnisme, c'est subordonner les faits historiques à une possible interprétation religieuse. C'est confondre le déterminisme biologique de la sélection naturelle avec un finalisme historico-religieux. Enfin, c'est prendre le risque de laisser croire, à tort, qu'il existe une concurrence explicative sur l'origine et l'histoire du vivant entre science et religion .
Exemples de Finalisme en biologie
Finalisme,locomotion,zoologie
La formule célèbre d’Aristote [la nature ne fait rien en vain], telle qu’elle est utilisée dans le traité sur la Locomotion des animaux, invite à reformuler le problème général du finalisme en zoologie et de la conformité à la nature. Bien que cette formule, en première approche, semble aller dans le sens d’une téléologie cosmique ou globale, elle conduit en fait à privilégier une téléologie relative, c’est-à-dire locale, qui opère à l’échelle des êtres vivants. Elle s’applique en effet, non pas de manière absolue, mais relativement aux possibilités définies par la nature de l’espèce (propriétés spécifiques et génériques). Toutefois, elle n’exprime pas seulement le rapport à la finalité organique stricto sensu, mais aussi les conditions nécessaires externes du mouvement animal, conditions qui définissent, pour les espèces et les genres, un régime commun d’organisation.
Aristote se propose d’examiner les conditions générales de la locomotion et les différences qui distinguent les animaux dans ce domaine. Pour ce faire, il annonce dès les premières lignes qu’il faut se demander « à quelle fin » tel ou tel animal possède telle ou telle partie . IA (Locomotion des animaux (De Incessu animalium) prend la locomotion elle-même comme fin et analyse les moyens que la nature met en œuvre pour l’atteindre. Ces moyens consistent essentiellement dans l’agencement et la conformation des parties. Ainsi, les rapaces ont une petite tête, un cou peu développé et une poitrine puissante et pointue, afin de traverser l’air aussi facilement qu’une embarcation légère traverse l’eau. L’explication de leur morphologie tient au bios, au mode de vie caractéristique de cette classe, genre d’existence qui requiert un vol rapide. Chez l’homme, la bipédie favorise l’usage des mains, car elles sont utiles pour saisir la nourriture, mais aussi, comme le montre PA, pour l’exercice de l’intelligence – tout au moins l’intelligence technique –, aptitude qui fait de lui « le plus intelligent des animaux »
Pour bien délimiter les enjeux, notons que IA ne se prononce pas, sinon de manière très indirecte, sur la cause finale intentionnelle de la locomotion, ce que l’animal identifie comme son bien, réel ou apparent, à savoir l’objet de désir ou le désirable. IA aurait pu s’y intéresser, si l’on considère que l’animal se meut en vue de se nourrir, de se reproduire, de fuir un danger, etc. Toutes ces activités, en effet, supposent la représentation d’un objet de désir, positif ou négatif, et un mouvement dont l’origine psychique est la faculté désirante. Ces questions sont abordées, en revanche, dans le traité De l’âme, mais aussi dans MA, qui se place en quelque sorte au-delà des différences de locomotion, en se situant explicitement au niveau de la cause « commune » à tout type de mouvement local – marche, vol, nage –, cause commune que la lecture de ce traité permet précisément d’identifier comme le bien particulier qui constitue pour l’animal l’objet de son désir. Le IA, peut-être par complémentarité, ne s’occupe pas pour sa part de la finalité intentionnelle et objective, c’est-à-dire des buts externes que l’animal poursuit sciemment et volontairement dans telles ou telles circonstances particulières. Il prend la locomotion elle-même comme fin et analyse les moyens que la nature met en œuvre pour l’atteindre. Ces moyens, je l’ai dit, consistent essentiellement dans l’agencement et la conformation des parties.
Sélection naturelle et finalisme
Sélection naturelle : principe universel, pendant scientifique du finalisme : explication de l'apparence de finalité car tendance automatique vers optima (locaux). Emerveillement sur la complexité de l'homme, de la vie, pas justifié : 4 milliards d'années d'évolution. Si la vie n'était pas bien organisée, nous ne pourrions pas le savoir (principe anthropique faible de l'astrophysique ; principe anthropique fort expliqué par la sélection naturelle).
Ainsi la sélection naturelle peut-elle justifier certaines théories sur la finalité de la nature, qui restent ainsi valables même si leur fondement est faux. Ex : la nature est prévoyante, mais en fait disparition des espèces non adaptées. Différence =pas prévoyante pour tout le monde, mais le fait que la nature cherche toujours la meilleure solution reste vrai.
 Questions possibles
Questions possibles
- Qu'est ce que le finalisme ?
- Qui sont les principaux penseurs finalistes ?
- Quelles sont les courants de pensées liés au finalisme ?
- Quelles sont les courants de pensées opposés au finalisme ?
- Quelle est la différence entre finalisme et efficience?
- Quelle est la relation entre causalité et finalité ?
- Quelles sont les courants de pensées domaines influencés par le finalisme ?
- Quelles sont les limites du finalisme ?
- Jusqu'à quel point s'accord le finalisme et le créationnisme ?
- Quelle est la relation entre finalisme et téléologie ?
- Comment influence le hasard sur le finalisme ?
 Bibliographie
Bibliographie
Pour citer cette page: ([1])
ABROUGUI, M & al, 2020. Finalisme. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Finalisme>, consulté le 1, juin, 2024
- Sponsors Question
- Philosophie - Conceptions
- Courant de pensée - Conceptions
- Épistémologie - Conceptions
- Histoire des sciences - Conceptions
- Finalisme - Conceptions
- Déterminisme - Conceptions
- Mécanisme - Conceptions
- Évolutionnisme - Conceptions
- Panthéisme - Conceptions
- Téléologie - Conceptions
- Créationnisme - Conceptions
- Anthropocentrisme - Conceptions
- Conceptions
- Nature - Conceptions
- Vie - Conceptions
- Biologie - Conceptions
- Finalité - Conceptions
- Causalité - Conceptions
- Efficience - Conceptions
- Religion - Conceptions
- Dieu - Conceptions
- Perspective téléologique - Conceptions
- Zoologie - Conceptions
- Fiches Conceptions
- Fiche Conceptions