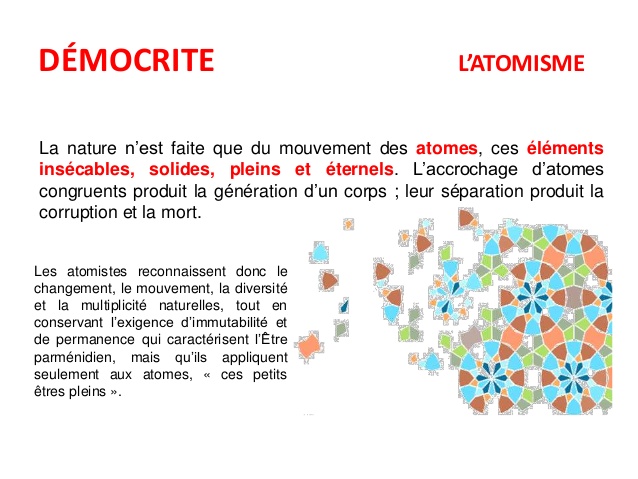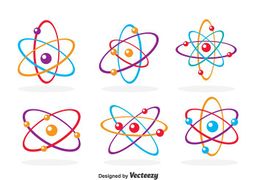Différences entre versions de « Mécanisme - Atomisme »
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
== La critique des entités scolastiques et chimiques == | == La critique des entités scolastiques et chimiques == | ||
| − | Atomistes et cartésiens s’accordent selon Boyle sur un point fondamental : « non seulement ils se soucient d’expliquer les choses intelligiblement, mais alors que les autres philosophes rendent compte des phénomènes naturels seulement en général et superficiellement, […] ils expliquent ces mêmes phénomènes par de petits corps diversement figurés et diversement mus ». Une personne de tempérament conciliant devrait donc les réunir sous la bannière d’une seule et même philosophie qu’il s’agit de nommer. « Parce qu’elle explique les choses par des corpuscules, c’est-à-dire par des corps minuscules, elle peut être appelée corpusculaire, quoique je la dénomme parfois philosophie phénicienne parce que certains écrivains de l’Antiquité nous apprennent que non seulement avant qu’Épicure et Démocrite, mais même avant que Leucippe n’enseignent en Grèce, un naturaliste phénicien avait entrepris de rendre raison des phénomènes naturels par le mouvement et les autres affections de minuscules particules matérielles. Et parce qu’elle est évidente et efficace dans le domaine des engins mécaniques, parfois | + | -Atomistes et cartésiens s’accordent selon Boyle sur un point fondamental : « non seulement ils se soucient d’expliquer les choses intelligiblement, mais alors que les autres philosophes rendent compte des phénomènes naturels seulement en général et superficiellement, […] ils expliquent ces mêmes phénomènes par de petits corps diversement figurés et diversement mus ». Une personne de tempérament conciliant devrait donc les réunir sous la bannière d’une seule et même philosophie qu’il s’agit de nommer. « Parce qu’elle explique les choses par des corpuscules, c’est-à-dire par des corps minuscules, elle peut être appelée corpusculaire, quoique je la dénomme parfois philosophie phénicienne parce que certains écrivains de l’Antiquité nous apprennent que non seulement avant qu’Épicure et Démocrite, mais même avant que Leucippe n’enseignent en Grèce, un naturaliste phénicien avait entrepris de rendre raison des phénomènes naturels par le mouvement et les autres affections de minuscules particules matérielles. Et parce qu’elle est évidente et efficace dans le domaine des engins mécaniques, parfois appelée aussi hypothèse ou philosophie mécanique » |
| + | -Boyle ne thématise pas ce qui fait le caractère intelligible d’une explication ; en fait, une explication intelligible, c’est simplement pour lui une explication plus intelligible qu’une autre explication moins intelligible. Montrer le bien-fondé d’une explication ne consiste ni à établir sa conformité à une norme a priori de l’intelligibilité, ni même exhiber son intelligibilité factuelle, mais à montrer qu’elle vaut mieux que d’autres explications possibles. Ainsi la défense de la philosophie mécanique qu’il propose consiste-t-elle principalement à mettre en lumière les déficiences des explications non-mécaniques, particulièrement celles des chimistes et des scolastiques. Les chimistes ont selon Boyle un mérite par rapport aux scolastiques : ils font des expériences. Mais d’un point de vue théorique, ils ne valent pas mieux ; se tourner vers les chimistes par dégoût des scolastiques c’est se précipiter de Charybde en Sylla, ou plus exactement de Charybde en Charybde. | ||
| + | -Les défauts que Boyle relève chez les uns et les autres sont innombrables : les chimistes emploient un langage équivoque et inconstant ; les scolastiques confondent propriétés du corps et passions de l’âme et forgent des êtres chimériques qui sont à la fois substances et accidents. La théorie chimique du mercure, du soufre et du sel, repose sur le présupposé que l’analyse des corps par le feu révèle leurs principes constituants, mais de nombreuses expériences indiquent que le feu n’est pas seulement un instrument de décomposition, mais un créateur d’artefacts. Fondamentalement cependant, les explications des chimistes et des scolastiques souffrent de deux défauts structurels, qui résultent de leur incapacité à comprendre la nature même d’une explication physique. | ||
| + | -prendre pour principes d’explication des substances concrètes comme les trois principes chimiques et les quatre éléments aristotéliciens conduit inévitablement à des contradictions. Etant donné la multiplicité des qualités phénoménales à expliquer, une même substance est chargée d’expliquer plusieurs qualités. | ||
| + | '''Exemple:''' Le sel est pour les chimistes cause de salinité mais aussi de dureté, la terre est pour les aristotéliciens cause de lourdeur mais aussi d’opacité. Il est dès lors impossible d’expliquer que certains corps manifestent une seule des qualités associées à un principe, par exemple qu’il existe des corps très salés et pas du tout durs, ou des corps très lourds et pas du tout transparents | ||
| + | <table class="wikitable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <th>Définition</th> | ||
| + | <th>Exemple</th> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> <td>Selon Boyle | ||
| + | </td> <td> | ||
| + | Expliquer un phénomène, c’est identifier, plutôt qu’une substance, le mécanisme d’une production. | ||
| + | |||
| + | </td> <td> | ||
| + | « Les différentes opérations [d’une horloge] ne s’accomplissent ni parce que ses roues sont de cuivre, de fer, ou d’un alliage de ces métaux, ni parce que ses poids sont de plomb, mais en vertu de la taille, de la figure, de la grosseur et de l’engrenage de ses différentes parties ; et elle accomplirait des opérations identiques, même si ses roues étaient d’argent, de plomb ou de bois, et ses poids de pierre ou d’argile, pourvu que l’assemblage et la disposition des parties demeurent identiques » | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </td> </tr> <tr> <td> | ||
| + | Explications | ||
| + | </td> <td> | ||
| + | la matière n’a pas une fonction explicative, mais une fonction ontologique : c’est le substrat universel commun à tous les corps16. Ce qui a une fonction explicative, ce sont les affections mécaniques de la matière, à savoir la taille, la grandeur et le mouvement des particules. Le mouvement est le plus important de ces trois termes. | ||
| + | |||
| + | </td> <td> | ||
| + | « Parce que la matière est une dans sa propre nature, la diversité qu’on voit dans les corps doit nécessairement provenir de quelque chose d’autre que de la matière dont ils sont constitués. Et comme on ne voit pas comment il pourrait y avoir un changement dans la matière si toutes ses parties […] étaient perpétuellement en repos les unes par rapport aux autres, il s’ensuit qu’[…] il doit y avoir du mouvement dans certaines de ses parties, […] et que ces mouvements doivent avoir diverses directions » | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </td> </tr> </table> | ||
| + | : Tableau:Les entités vues par Boyle | ||
| + | |||
Version du 13 juillet 2020 à 19:42
 Conception : Clarification - Explicitation
Conception : Clarification - Explicitation
Mécanisme Atomisme
L'atomisme est une théorie philosophique proposant une conception d'un univers composé de matière et de vide. Selon les atomistes, les atomes composant l'univers sont tous de même substance.Ils sont insécables et ne changent les uns des autres que par leurs formes et leurs positions.
Avec l'émergence du mécanisme dans le premier tiers du XVIIe siècle, la conception corpusculaire de la réalité, héritée de l'atomisme antique, va trouver une nouvelle actualité scientifique. Sous-jacente aux apparences sensibles, la réalité physique se présente comme une série variable de combinaisons entre des éléments matériels. Le scientifique qui maîtrise les lois qui régissent cette combinatoire n'aura aucun mal à passer du simple au complexe, et réciproquement.
Le mécanisme paraît au contraire introduire dans l'histoire de l'idée de nature une discontinuité. Il n'a pas eu de précurseurs immédiats. Plusieurs mécanistes toutefois se cherchèrent des antécédents et se réclamèrent des philosophes atomistes, mais Démocrite, Épicure ou Lucrèce leur ont apporté un modèle plus qu'une source de doctrine. Et, de toute façon, le mécanisme n'est pas lié nécessairement à l'atomisme ; ainsi celui de Descartes, le plus célèbre.
- Les conceptions des Anciens : Démocrite, Epicure et Lucrèce, oubliés pendant toute l’antiquité furent à nouveau redécouvertes au début du 17ème siècle.
Dans l’antiquité et au Moyen-Âge, on comprend qu’elles aient été délaissées car l’homme avait l’esprit occupé par le salut, la divinité et dieu. La théorie des éléments qui conservait l’idée d’un dieu organisant les éléments, et de divinités telles que l’eau, le feu, l’air et la terre dont la mythologie raconte le rôle, correspondait mieux à la mentalité des individus. Mais au début du 17ème, après la Renaissance et le courant humaniste, le matérialisme des doctrines atomistes, moins élaboré que les transmutations d’Aristote est mieux compris. Après de nombreuses tentatives infructueuses, les efforts des atomistes s’allièrent avec la méthode mécaniste de Descartes. Les différentes doctrines corpusculaires conquirent d’abord la philosophie, la médecine puis la chimie elle-même. La théorie aristotélicienne et le courant alchimique furent en partie délaissés par les savants et les chimistes. Les connaissances chimiques se séparèrent en deux courants dont un seul, reprenant les idées des Anciens et soutenu par la philosophie de Descartes, s’inscrit dans le cadre du renouveau intellectuel de la chimie. L'autre courant, l'alchimie, persistera encore plusieurs siècles mais ne sera plus le courant dominant.
- LE RENOUVEAU DE LA DOCTRINE ATOMIQUE : LA PHILOSOPHIE CORPUSCULAIRE ET LA THEORIE MECANISTE DE DESCARTES
La philosophie corpusculaire constitue une nouvelle tentative d’explications des phénomènes chimiques. Ses fondateurs grecs : Leucippe, Démocrite, Lucrèce et Epicure définissent la matière mais également le vide. La matière est constituée de parties pleines et de parties vides, elle n’est donc ni homogène ni continue. Les parties pleines sont appelées les atomes, ce que l’on ne peut pas couper. Chacun de ces atomes a une forme déterminée ; l’immense diversité géométrique et les multiples façons dont les atomes peuvent s’assembler permet d’expliquer la formation de tout ce qui existe. Par exemple les corps les plus durs doivent leurs cohésion à des atomes très crochus et très entrelacés ; au contraire les liquides sont formés d’atomes lisses et ronds qui roulent aisément. Cette théorie est donc entièrement reprise par les atomistes du début du 17ème siècle. Pierre Gassendi (1592-1655) fut le premier savant qui tenta de la réhabiliter en l’enseignant et en l’appliquant . "La matière discontinue est formée d’atomes indivisibles, indéformables, inaltérables, parfaitement durs et différents." C'est Descartes qui réussit à la réintroduire entièrement et à lui donner une place prépondérante. René Descartes s’est peu occupé de la chimie mais sa philosophie de la matière a pourtant profondément influencé cette science. Son influence ne s’est donc manifestée qu’indirectement. Il a donné aux médecins, aux chimistes l’habitude de penser autrement. Ils les a entraînés peu à peu à construire leur science sur de nouvelles bases et par suite à la modifier considérablement. Descartes apporte deux nouveaux aspects aux doctrines atomiques qui vont d’une part donner à la chimie corpusculaire, le point de départ stable d’une chimie plus moderne et d’autre part permettre aux savants de faire correspondre une image sensible aux concepts abstraits de la chimie : la forme et le mouvement Il s’entend sur quelques points fondamentaux avec les atomistes mais enrichit leur théorie par celle du mouvement mais sa conception de la matière est différente car il nie l’existence du vide. Sa théorie est donc corpusculaire mais ne s’intègre pas dans une vision atomique de la matière. Son plus grand apport à la chimie est lié à son soutien et à son perfectionnement de la théorie des Anciens telle que la diffusait Gassendi au début du 17ème siècle. Descartes admet que la matière est confondue avec l’espace et que les différences observées macroscopiquement se réduisent en fait à la différence de figuration présentée par les molécules qui les composent. Il garde l’idée que les atomes ont des formes particulières mais l’idée un peu simpliste des atomes crochus de Lucrèce est remplacée et perfectionnée par l’attribution de formes géométriques définies et mathématiques aux atomes. Les atomes ne s’emmêlent plus mais s’empilent, se juxtaposent… A l’opposé des atomistes, Descartes refuse l’existence du vide. Les atomes ne sont pas séparés par des espaces vides. Autour d’eux se meuvent des particules encore beaucoup plus petites. Tout baigne dans une sorte de fluide subtil qui emplit les interstices entre les corpuscules et les entoure. Enfin un postulat fondamental est que la description des corps naturels n’est pas séparable de l’histoire de leur formation. C’est dans les "Principes" que Descartes présente une fiction racontant l’histoire de la création. A l’origine la matière était constituée de minuscules cubes empilés de façon parfaitement jointive, sans aucun espace entre leurs faces. Bientôt le mouvement agit sur ces cubes, les fait tourner en raison de ²tourbillons². Alors, leurs arêtes se brisent, générant soit une fine poussière (la matière subtile), soit des morceaux de formes aléatoires (la matière irrégulière). Ce qui reste des cubes après disparition des arêtes forme la matière globuleuse. C’est l’aspect mécaniste de la théorie de Descartes qui va être la plus convaincante pour les chimistes
- La théorie mécaniste
Descartes dote les atomes d’un mouvement perpétuel qui leur a été communiqué lors de leur création. Il laisse entendre que, grâce à sa théorie, une interprétation mécanique de la chimie devient possible. La nouvelle vision de l’univers formé d’atomes en mouvement lui permettra d’expliquer leur combinaison mécanique lors des réactions chimiques. Le calcul du mouvement des atomes pourrait permettre d’établir le mécanisme et la prévision des réactions en fonction des corps utilisés. Les réactions chimiques ne sont que la traduction sensible des phénomènes mécaniques, suite au mouvement imprimé à la matière lors de sa création. Les corps mus et figurés de Descartes exercent dans la première moitié du 18ème siècle une séduction irrésistible sur un très grand nombre d’esprits. Sa philosophie mécanique ramenait à l’unité la complexité des phénomènes matériels. Nicolas Lémery(1645-1715), médecin de formation, ouvre un cours de chimie à Paris. Son succès est immense car il se réfère à des expériences concrètes. Nicolas Lémery n’est pas seulement un expérimentateur c’est aussi un théoricien. Il publie en 1675 son fameux ²Cours de chimie² dans lequel il énonce : L’alchimie est la chimie qui enseigne la transmutation des métaux. La chimie est un art qui enseigne à séparer les différentes substances qui se rencontrent dans un mixte.² (cf. annexe). En effet, il ne veut rien devoir à l’alchimie qu’il distingue d’emblée de la chimie. Afin de construire sur le socle solide de Descartes, il considère que les phénomènes observés en chimie ont leur origine dans les formes des particules décrites par le philosophe. Il construit un roman cartésien où les seuls acteurs sont figure et mouvement : -Une liqueur est acide car elle contient des particules pointues qui piquent la langue. -La force d’un acide dépend de la finesse des pointes de ses particules. -Le calcaire rentre en effervescence en contact avec un acide car il est constitué de particules raides et cassantes qui sont brisées par le mouvement des pointes de l’acide -Les sels neutres peuvent se décomposer et se reconstituer en acide : les pointes de l’acide entrent dans les pores du sel comme une épée dans un fourreau, l’acidité est juste masquée et non détruite… Selon les rapports géométriques pointe acide / pore alcali, les particules d’alcali peuvent se briser au cours de la réaction expliquant du même coup le phénomène d’effervescence. Les explications de Lémery sont simplistes. C’est là précisément son mérite. C’est la clarté de l’expression, la volonté de rompre avec le mystère qui caractérisent son enseignement. Fontenelle (1657-1757) put dire à propos de Lémery La chimie avait été jusque-là une science, où, pour emprunter ses propres termes (ceux de Lémery), un peu de vrai était tellement dissous dans une grande quantité de faux, qu’il était devenu invisible, et tous deux presque inséparables. Pendant une très courte période, la chimie fut enfin érigée en science populaire accessible et intelligible par tous.
- Robert Boyle (1627-1691) pense que la seule théorie possible est mécaniste. Il considère que la conséquence en est que tous les corps sont produits par des textures différentes² d’une²matière catholique ou universelle.² En ce qui concerne la pratique, le chimiste doit se conformer à ²l’analyse chimique en travaillant à l’accumulation d’un savoir pratique toujours plus précis.
De ce fait, Boyle engage définitivement la chimie sur le chemin de l’expérience. En 1661, dans ²The Sceptical Chymist², il plaide pour une confrontation systématique des théories à l’expérience. C’est la première fois qu’est opposé à l’autorité de l’auteur ce que Boyle appelle ²the matter of fact² qui seul permet de certifier la théorie. Boyle sut dépasser le simple niveau de l’expérimentation par l’impulsion qu’il donna à une réflexion rationnelle dans l’interprétation des phénomènes chimiques. Ses travaux expérimentaux le conduisent à employer un certain nombre de réactifs, à utiliser aussi le test de la flamme permettant de reconnaître une substance selon la coloration obtenue. Physicien, il introduit dans la pratique de la chimie l’emploi de machines et d’instruments de précision dans les recherches. La polémique lancée par DESCARTES sur l’existence du vide conduit Boyle à démontrer la possibilité de faire diminuer la pression de l’air avec une pompe à air. Le laboratoire est le lieu de démonstration d’une vérité qui, grâce aux témoins présents, se propagera dans toute l’Europe. Ce physicien a aussi le principal mérite d’avoir distingué le simple mélange d’avec le composé chimique en montrant que celui-ci avait des propriétés plus ou moins différentes que celles des corps qui le constituaient tandis que les corps d’un mélange conservaient toutes leurs propriétés spécifiques. Mais Boyle, dans la lignée de Descartes, imagine des hypothèses pour expliquer des cas d’actions moléculaires où il y a combinaison par des causes mécaniques ou même physiques. C’est la raison pour laquelle Boyle n’a pu approfondir les conséquences de la distinction qu’il avait établie.
La critique des entités scolastiques et chimiques
-Atomistes et cartésiens s’accordent selon Boyle sur un point fondamental : « non seulement ils se soucient d’expliquer les choses intelligiblement, mais alors que les autres philosophes rendent compte des phénomènes naturels seulement en général et superficiellement, […] ils expliquent ces mêmes phénomènes par de petits corps diversement figurés et diversement mus ». Une personne de tempérament conciliant devrait donc les réunir sous la bannière d’une seule et même philosophie qu’il s’agit de nommer. « Parce qu’elle explique les choses par des corpuscules, c’est-à-dire par des corps minuscules, elle peut être appelée corpusculaire, quoique je la dénomme parfois philosophie phénicienne parce que certains écrivains de l’Antiquité nous apprennent que non seulement avant qu’Épicure et Démocrite, mais même avant que Leucippe n’enseignent en Grèce, un naturaliste phénicien avait entrepris de rendre raison des phénomènes naturels par le mouvement et les autres affections de minuscules particules matérielles. Et parce qu’elle est évidente et efficace dans le domaine des engins mécaniques, parfois appelée aussi hypothèse ou philosophie mécanique » -Boyle ne thématise pas ce qui fait le caractère intelligible d’une explication ; en fait, une explication intelligible, c’est simplement pour lui une explication plus intelligible qu’une autre explication moins intelligible. Montrer le bien-fondé d’une explication ne consiste ni à établir sa conformité à une norme a priori de l’intelligibilité, ni même exhiber son intelligibilité factuelle, mais à montrer qu’elle vaut mieux que d’autres explications possibles. Ainsi la défense de la philosophie mécanique qu’il propose consiste-t-elle principalement à mettre en lumière les déficiences des explications non-mécaniques, particulièrement celles des chimistes et des scolastiques. Les chimistes ont selon Boyle un mérite par rapport aux scolastiques : ils font des expériences. Mais d’un point de vue théorique, ils ne valent pas mieux ; se tourner vers les chimistes par dégoût des scolastiques c’est se précipiter de Charybde en Sylla, ou plus exactement de Charybde en Charybde. -Les défauts que Boyle relève chez les uns et les autres sont innombrables : les chimistes emploient un langage équivoque et inconstant ; les scolastiques confondent propriétés du corps et passions de l’âme et forgent des êtres chimériques qui sont à la fois substances et accidents. La théorie chimique du mercure, du soufre et du sel, repose sur le présupposé que l’analyse des corps par le feu révèle leurs principes constituants, mais de nombreuses expériences indiquent que le feu n’est pas seulement un instrument de décomposition, mais un créateur d’artefacts. Fondamentalement cependant, les explications des chimistes et des scolastiques souffrent de deux défauts structurels, qui résultent de leur incapacité à comprendre la nature même d’une explication physique. -prendre pour principes d’explication des substances concrètes comme les trois principes chimiques et les quatre éléments aristotéliciens conduit inévitablement à des contradictions. Etant donné la multiplicité des qualités phénoménales à expliquer, une même substance est chargée d’expliquer plusieurs qualités.
Exemple: Le sel est pour les chimistes cause de salinité mais aussi de dureté, la terre est pour les aristotéliciens cause de lourdeur mais aussi d’opacité. Il est dès lors impossible d’expliquer que certains corps manifestent une seule des qualités associées à un principe, par exemple qu’il existe des corps très salés et pas du tout durs, ou des corps très lourds et pas du tout transparents
| Définition | Exemple | |
|---|---|---|
| Selon Boyle |
Expliquer un phénomène, c’est identifier, plutôt qu’une substance, le mécanisme d’une production. |
« Les différentes opérations [d’une horloge] ne s’accomplissent ni parce que ses roues sont de cuivre, de fer, ou d’un alliage de ces métaux, ni parce que ses poids sont de plomb, mais en vertu de la taille, de la figure, de la grosseur et de l’engrenage de ses différentes parties ; et elle accomplirait des opérations identiques, même si ses roues étaient d’argent, de plomb ou de bois, et ses poids de pierre ou d’argile, pourvu que l’assemblage et la disposition des parties demeurent identiques »
|
|
Explications |
la matière n’a pas une fonction explicative, mais une fonction ontologique : c’est le substrat universel commun à tous les corps16. Ce qui a une fonction explicative, ce sont les affections mécaniques de la matière, à savoir la taille, la grandeur et le mouvement des particules. Le mouvement est le plus important de ces trois termes. |
« Parce que la matière est une dans sa propre nature, la diversité qu’on voit dans les corps doit nécessairement provenir de quelque chose d’autre que de la matière dont ils sont constitués. Et comme on ne voit pas comment il pourrait y avoir un changement dans la matière si toutes ses parties […] étaient perpétuellement en repos les unes par rapport aux autres, il s’ensuit qu’[…] il doit y avoir du mouvement dans certaines de ses parties, […] et que ces mouvements doivent avoir diverses directions »
|
- Tableau:Les entités vues par Boyle
![]() Conceptions erronées et origines possibles
Conceptions erronées et origines possibles
- Se soucier d’expliquer les choses intelligiblement, mais alors que les autres philosophes rendent compte des phénomènes naturels seulement en général et superficiellement, ils expliquent ces mêmes phénomènes par de petits corps diversement figurés et diversement mus.
==> Une personne de tempérament conciliant devrait donc les réunir sous la bannière d’une seule et même philosophie qu’il s’agit de nommer. « Parce qu’elle explique les choses par des corpuscules, c’est-à-dire par des corps minuscules, elle peut être appelée corpusculaire, quoique je la dénomme parfois philosophie phénicienne parce que certains écrivains de l’Antiquité nous apprennent que non seulement avant qu’Épicure et Démocrite, mais même avant que Leucippe n’enseignent en Grèce, un naturaliste phénicien avait entrepris de rendre raison des phénomènes naturels par le mouvement et les autres affections de minuscules particules matérielles.
- Idéaliser les explications des chimistes et des scolastiques.
==> Fondamentalement cependant, les explications des chimistes et des scolastiques souffrent de deux défauts structurels, qui résultent de leur incapacité à comprendre la nature même d’une explication physique; les chimistes emploient un langage équivoque et inconstant ; les scolastiques confondent propriétés du corps et passions de l’âme et forgent des êtres chimériques qui sont à la fois substances et accidents
![]() Conceptions: Origines possibles
Conceptions: Origines possibles
- Boyle a longtemps fait figure de héros pour avoir réuni deux choses jusqu’alors séparées : la chimie et la théorie corpusculaire de la matière. Cette union aurait été fructueuse aussi bien pour la chimie, qui se serait enfin dégagée de sa gangue pré-scientifique, que pour la théorie corpusculaire, qui aurait enfin reçu un fondement expérimental. Ainsi Marie Boas-Hall pouvait-elle écrire que la philosophie mécanique de Boyle était a complete and well-developed theory, founded upon experiments, adequate to explain all the properties of matter, and both rational and empirical1. Plusieurs historiens des sciences se sont attachés ces dernières années à déconstruire cette image trop parfaite, et l’on tient maintenant pour acquis d’une part que Boyle devait plus aux théories alchimiques qu’il voulait bien le reconnaître et d’autre part que certains chimistes avaient avant lui conjoint pratique chimique et théorie corpusculaire de la matière.
 Conceptions liées - Typologie
Conceptions liées - Typologie
 Concepts ou notions associés
Concepts ou notions associés
épistémologie / courant de pensée / Mouvement / Dynamisme / matière/corps / atome / fragment / atome vital / Biologie / Physique quantique / indivisibilité / Religion / nature / la théorie cellulaire / la théorie fibrillaire / substance plastique fondamentale / génétique orthodoxe / la génétique mitchourienne / paradigme atomiste /
| Références
| |||
|---|---|---|---|
|
Sur le Portail Questions / Réponses |
Sur Portail de Formation Gratuite |
Sur des sites de Formation |
Sur DidaQuest |
| Mécanisme - Atomisme sur : Wikipedia / Wikiwand / Universalis / Larousse encyclopédie / Khan Académie | |||
| Sur Wikiwand :
épistémologie / courant de pensée / Mouvement / Dynamisme / matière/corps | |||
| Sur Wikipédia :
épistémologie / courant de pensée / Mouvement / Dynamisme / matière/corps | |||
| Sur Wikiversity :
épistémologie / courant de pensée / Mouvement / Dynamisme / matière/corps | |||
| Sur Universalis :
épistémologie / courant de pensée / Mouvement / Dynamisme / matière/corps | |||
| Sur Khan Académie :
épistémologie / courant de pensée / Mouvement / Dynamisme / matière/corps | |||
 Éléments graphique
Éléments graphique
 Stratégie de changement conceptuel
Stratégie de changement conceptuel
- En histoire des sciences
- La délimitation historique de la catégorie de philosophie mécanique est exactement aussi problématique que sa définition conceptuelle ; il est difficile de déterminer raisonnablement quand commence la philosophie mécanique et quand elle finit.Prenons par exemple l’idée que tout doit pouvoir être réduit à des mouvements de la matière : cette exigence est constitutive de l’atomisme antique, et par conséquent de sa résurrection dès le XVIe siècle. Pourquoi ne pas inclure en ce cas parmi les philosophes mécaniques ceux qui les premiers ont redécouvert l’atomisme antique, des auteurs encore mal connus comme Sennert, Basson, Bérigard, Gorlée, Jungius, Beeckman ? Et, si l’on considère non plus le terminus a quo mais le terminus ad quem, peut-on ranger sous la même catégorie la philosophie mécanique du XVIIe siècle, qui stigmatise la force comme une notion occulte, et les mécanismes des XVIIIe et XIXe siècles,qui
recourent sans cesse à des attractions non seulement mécaniques, mais électromagnétiques ? C’est eu égard à ces questions qu'on préfère parler de “philosophie mécanique” plutôt que de “mécanisme” : la catégorie de mécanisme n’étant nullement située dans le temps, son emploi présuppose que le mécanisme demeure fondamentalement identique depuis l’atomisme antique jusqu’à la fin du XIXe siècle ; or cette identité n’a rien d’évident.
Le principal théoricien de l'atomisme au XVIIe siècle est Pierre Gassendi (1592-1655). Épicure, qu'il a longuement étudié, lui fournit un modèle épistémologique, qui lui évite également de tomber dans les pièges d'un rationalisme dogmatique et d'un scepticisme ravageur. En tant qu'hypothèse explicative, compatible avec la conception chrétienne d'un Dieu créateur, l'atomisme rend parfaitement compte des qualités sensibles dont nous avons l'expérience, tout en fournissant un modèle satisfaisant pour l'organisation des données du monde observable.
À la même époque, l'invention du microscope permet de vérifier expérimentalement l'existence d'« atomes » qui jusque-là, restaient des entités purement théoriques. Le débat se déplace alors sur un autre terrain : celui de la nature et de l'identification des particules élémentaires dont le conglomérat façonne la réalité empirique.
À partir du XIXe siècle, la théorie atomique devient la chasse gardée des « sciences dures ». Dans le champ philosophique, l'atomisme va connaître un nouveau printemps grâce à certains représentants de la philosophie analytique. C'est le courant de l'atomisme logique, illustré par Bertrand Russell (1872-1970) et le « premier » Wittgenstein (1889-1951).
- Dans l'Antiquité, les atomistes restèrent des isolés qui n'eurent guère de disciples et le Moyen Âge les ignora ou ne voulut pas les connaître parce qu'ils faisaient figure d'impies. Mais, au XVIIe siècle, la doctrine retrouva un regain de faveur grâce à plusieurs des philosophes mécanistes, tels Galilée, qui se référa à Démocrite, et Gassendi, qui écrivit une vie d'Épicure et se déclara épicurien. Ils reprirent à leur compte l'idée d'une composition atomique de la matière ; elle leur permettait de se débarrasser de la physique aristotélicienne et des philosophies naturelles de la Renaissance. En faisant des corps des conglomérats d'atomes unis par hasard, en expliquant les qualités sensibles comme produites par ces corpuscules qui sont en eux-mêmes sans qualités, en relativisant l'espace, c'est-à-dire en rejetant l'idée d'un haut et d'un bas absolus, les atomistes repoussaient toute physique qualitative et toute idée finaliste ou panpsychique de la nature. Le monde, et le monde tout entier – car il n'y avait pas pour eux de distinction à faire entre le monde sublunaire et le monde astral –, était fait d'une matière inerte. On conçoit donc que les mécanistes aient été séduits par cet atomisme antique qui leur apportait une cosmologie et une physique beaucoup plus en accord avec leurs propres perspectives que la philosophie d'Aristote.
- Très tôt dans l'histoire de la pensée grecque, on voit se constituer une école de philosophes atomistes, l'école d'Abdère. On ignore tout du fondateur de cette école, Leucippe, mais on connaît par quelques textes la pensée de son disciple Démocrite, un contemporain de Socrate. L'atomisme fut repris et développé par Épicure (341-271), puis, au premier siècle avant J.-C., il s'introduisit à Rome, où Lucrèce (97-55) lui consacra son grand poème, le De rerum natura.
- Exemples en biologie
- En génétique
Hugo de Vries expose sommairement l'ensemble des recherches qu'il poursuit depuis plusieurs années sur la transmission 'des caractères chez diverses plantes (Datura, Lychnis, Œnothère, Solanum, Papaver, Viola, Zea, etc.). Ayant croisé entre elles des variétés différentes de ces végétaux, il a constaté que les caractères des formes parentes se transmettent à la descendance suivant des règles très simples, qui ne se peuvent expliquer qu'au moyen de certaines hypothèses. Tout se passe comme si chaque caractère correspondait à une forme particulière de facteur matériel (trâger). Ces facteurs déterminateurs de caractères sont indépendants les uns des autres, puisque, dans leur transmission, ils peuvent se séparer, se « ségréger ». De Vries voit dans ces résultats expérimentaux une confirmation de sa théorie particulaire des pangènes, théorie qui avait d'ailleurs été l'inspiratrice de ses recherches.
- L'atomisme et la théorie cellulaire
la théorie cellulaire, non moins que la théorie fibrillaire de Haller, que la théorie des molécules organiques de Buffon, ou que les différentes théories granulaires sur la constitution morphologique des êtres vivants qui se succèdent au 18e et 19e siècles (pour ne prendre que des exemples de théories biologiques de l’époque moderne) participent du « paradigme atomiste » en biologie, puisque aussi bien elles postulent toutes la nature composée du tout vivant, sa division en parties élémentaires irréductibles. – Mais toutes ces théories ne sont pas, loin de là, associationnistes (au vrai, seule la doctrine buffonienne des molécules organiques peut être dite telle). L’associationnisme implique en outre que le tout est un produit de l’association des parties, donc que les parties existaient à l’état séparé préalablement à leur association en tout, que l’existence du tout est postérieure à celle de ses parties : « La vie de l’animal ou du végétal, dit ainsi Buffon, ne paraît être que le résultat de toutes les actions, de toutes les petites vies particulières [...] de chacune de ces molécules actives dont la vie est primitive et paraît ne pouvoir être détruite. [...] Il n’est donc pas difficile de concevoir que, quand un certain nombre de ces molécules sont réunies, elles forment un être vivant 72 » . Une des implications essentielle de l’associationnisme est donc celle-ci, qui touche à la question de l’individualité : une conception de l’être vivant comme association de parties primitivement séparées est pour le moins difficilement compatible avec l’idée selon laquelle le tout constitue un individu : l’individualité peut se dire des parties, non du tout, quand bien même l’association, loin d’être une coopération réfléchie et voulue par les individus participants, comme c’est le cas pour Buffon s’agissant des sociétés animales et a fortiori des organismes complexes 73 , résulte de causes toutes mécaniques. Bref, l’associationnisme n’est qu’une des spécifications, parmi d’autres possibles, de la conception atomiste sous le rapport des statuts respectifs, plus précisément sous le rapport de la position chronologique et logique respective (pour autant que le caractère d’individualité est un signe de supériorité logique pour son sujet d’attribution) du tout et des parties.
La théorie cellulaire n’est donc qu’un cas particulier d’atomisme en biologie, comme la théorie des molécules organiques, de même genre qu’elle mais d’espèce différente dans la mesure où elle n’implique, contrairement à cette dernière, aucune espèce d’adhésion à la thèse associationniste, conception selon laquelle l’existence séparée des individus est le fait primitif, la constitution de l’organisme le fait second.
 Questions possibles
Questions possibles
- Comment expliquer la relation mécanisme-atomisme ?
- Quelles sont les différences entre cartésiens et atomistes ?
- Quels exemples trouve t-on pour l'application de ces courants de pensée en biologie ?
- Quels exemples illustrant l'antagonisme entre ces deux courants ?
- Sur quel point s'accordent les atomistes et les cartésiens ?
- Les penseurs grecs, comment ont il forgé la notion d'atome avant la naissance de la théorie atomique ?
- Quelles conceptions adoptées par les mécanistes et les atomistes vis à vis le vide ?
 Bibliographie
Bibliographie
Pour citer cette page: (- Atomisme)
ABROUGUI, M & al, 2020. Mécanisme - Atomisme. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/M%C3%A9canisme_-_Atomisme>, consulté le 2, juin, 2025
- G. Canguilhem : « La théorie cellulaire »
- Esquisse d'une histoire de l'atomisme en biologie Jean Rostand
- ..................
- ..................
- Sponsors Question
- Épistémologie - Conceptions
- Courant de pensée - Conceptions
- Philosophie - Conceptions
- Histoire des sciences - Conceptions
- Mécanisme - Conceptions
- Matérialisme - Conceptions
- Mécanisme - Atomisme - Conceptions
- Monisme - Conceptions
- Associationnisme - Conceptions
- Conceptions
- Mouvement - Conceptions
- Dynamisme - Conceptions
- Matière/corps - Conceptions
- Atome - Conceptions
- Fragment - Conceptions
- Atome vital - Conceptions
- Biologie - Conceptions
- Physique quantique - Conceptions
- Indivisibilité - Conceptions
- Religion - Conceptions
- Nature - Conceptions
- La théorie cellulaire - Conceptions
- La théorie fibrillaire - Conceptions
- Substance plastique fondamentale - Conceptions
- Génétique orthodoxe - Conceptions
- La génétique mitchourienne - Conceptions
- Paradigme atomiste - Conceptions
- Fiches Conceptions
- Fiche Conceptions